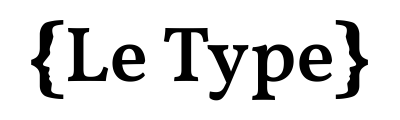Rencontre au long cours avec Claude Darmanté et Jean-Pierre Andrien, membres de l’équipe du collectif Espace Marx qui coordonne l’organisation des Rencontres de la classe ouvrière c’est pas du cinéma. L’événement qui porte les luttes ouvrières à l’écran fête du 13 au 18 février ses 20 ans, entre projection, tables-rondes et échanges.
Le Type : Pouvez-vous nous résumer vos parcours respectifs au sein du collectif Espace Marx et des Rencontres de la classe ouvrière c’est pas du cinéma ?
Claude Darmanté : Je m’appelle Claude Darmanté, depuis quelques années j’assure la coordination des Rencontres. C’est une programmation qui est décidée collectivement avec des journées qui sont portées par différents membres de l’équipe.
Jean-Pierre Andrien : Je m’appelle Jean-Pierre Andrien, j’ai rejoint l’équipe plus tardivement que Claude. Cela fait 7 ou 8 ans que je suis investi de façon importante dans cette équipe. Cette année, je porte avec Patrick Sagoryla la journée du jeudi 15 consacrée au travail de fin de carrière. Comme le disait Claude, chaque personne dans l’équipe donne son avis sur la programmation.
Claude : Cette année, ça s’est plutôt bien passé. Il y a des années où l’on n’arrive pas à choisir…
Jean-Pierre : Oui, il y a des petites « batailles. » On a des regards différents sur ce que nous allons présenter.
Claude : C’est lié au fonctionnement de l’équipe qui est uniquement composée de bénévoles et qui évolue au fil du temps. Chacun·e prend la place qu’il souhaite. Tout le monde n’est pas tenu de porter une journée. On est dans cette souplesse ou l’on essaye de concevoir ensemble cette semaine avec des regards différents. Pour nous, c’est important d’avoir cette diversité.

Ce sont les vingt ans des Rencontres de « la classe ouvrière c’est pas du cinéma. » Qu’est ce que représente cet anniversaire pour vous ? Et comment cela s’incarne dans la programmation de cette année ?
Claude : C’est une initiative qui a été créée sans que l’on sache si elle allait perdurer. Ce fut finalement le cas, au fil des années, sauf en 2020 à cause du COVID. C’est un projet qui a pu élargir son champ et ses publics : c’est très positif.
Pour ce qui est de la programmation de la vingtième, il y a plusieurs clins d’œil aux éditions précédentes. Le premier, c’est que, cette année, il y a une journée consacrée aux luttes ouvrières en Afrique du Sud. À l’origine des Rencontres, le questionnement que nous souhaitons soulever était celui de la représentation des ouvrier·es au cinéma, autant dans les fictions que dans les documentaires. Il s’agissait donc de revenir à cette thématique centrale.
Le second clin d’œil est celui de la journée consacrée à Jean-Luc Godard. Là aussi, nous nous sommes questionnés sur la représentation de ceux qui « travaillent », au cinéma. Au fil des années, nous avons projeté différents films et différents documentaires où les cinéastes se questionnent sur « comment représenter la classe ouvrière ? Par quel outil cinématographique représente-t-on les luttes ? ». Avec cette programmation, il y a une façon de boucler quelque chose.
Pour le reste de la programmation, on est dans la continuité des années précédentes, avec une journée consacrée à l’Amérique Latine, une journée en collaboration avec le département hygiène sécurité environnement. Il y a aussi un focus sur un cinéaste. Il s’agit de choses que nous avons inscrites dans la durée.
On a jamais souhaité proposer quelque chose qui soit strictement français.
Claude Darmanté
Lorsque l’on regarde la programmation du festival cette année, et de manière générale tous les ans, il y a quelque chose qui marque : c’est la pluralité des nationalités des auteur·ices et de leurs œuvres. Cette année, par exemple, il y a une journée consacrée à l’Amérique Latine, une autre à l’Afrique du Sud, une troisième à l’Iran, une journée consacrée au cinéaste israélien Nadav Lapid avec la diffusion de plusieurs de ses films… En quoi cette idée d’internationalité de la lutte ouvrière est-elle importante pour vous ?
Claude : C’est important parce qu’on a jamais souhaité proposer quelque chose qui soit strictement français. Même si, au début des Rencontre, nous avions une programmation davantage axée sur le cinéma français, au fil des années sans même nous poser la question, ça nous semblait évident que nous voulions proposer davantage.
D’autre part, balayer de manière large de la sorte diverses nationalités nous permet d’aborder des réalités sociales, économiques, politiques très différentes, mais aussi des écritures cinématographiques diverses et les rencontres tournent autour de la question de la classe ouvrière certes, mais c’est avant tout des rencontres cinématographiques. Ce qui nous uni reste le plaisir du cinéma, le plaisir de découvrir des films. Et c’est important d’aller voir ce qui peut se faire aux quatre coins du monde où l’on trouve à la fois des points communs, mais aussi de grande diversité sociale, politique et cinématographique.
Jean-Pierre : Je rajouterais qu’il y a aussi une volonté de traiter de l’actualité internationale par les choix de programmation : l’année précédente, il y avait une journée consacrée à l’Ukraine. Cette année, il y a la journée consacrée aux femmes iraniennes. Et la volonté de consacrer une journée sur la fin de carrière fait évidemment écho au récent événement de la réforme des retraites en France.
D’ailleurs, il y a dans cette journée du 15 février consacré à la fin de carrière la diffusion de I Daniel Black un film de Ken Loach qui est anglais. Or, on aurait tendance à considérer le débat des retraites comme très « français » compte tenu de l’actualité. C’est un choix volontaire ?
Jean-Pierre : Oui, le film de Ken Loach montre que dans certains pays européens – puisque l’Angleterre faisait encore partie de l’Union européenne à l’époque de la sortie du film – la situation était encore plus dure.
Claude : Les points communs que l’on retrouve, c’est la dégradation des conditions de travail, avec ce que ça implique d’usure physique et psychologique qui arrivent très vite. En termes de pathologie, il y a bien sûr la douleur physique, mais il y a aussi les situations de burn-out qui se retrouvent chez des personnes qui atteignent à peine la quarantaine et qui ont encore des décennies de travail qui les attendent.
C’est quelque chose qui existe malheureusement dans la plupart des pays et qui est souvent sous-estimé. Il y a des débats sur la pénibilité des métiers physiquement difficiles. On pense traditionnellement – et à juste titre – à certain secteur d’activité, sauf que l’on s’aperçoit maintenant que dans les secteurs tertiaires ce n’est certes pas la charge physique qui va éprouver le salarié, mais il y a une usure, par la charge mentale d’une part, mais aussi par les gestes répétitifs, accélérés qui font des dégâts énormes.

En plus de cette pluralité de nationalités, on note aussi dans la programmation, des films sortis à diverses périodes, contemporains pour certains, et plus anciens pour d’autres. Je pense notamment à Come Back Africa, film sud-africain de 1959. Ou encore, la journée du dimanche 18 février qui sera consacrée au cinéma de Jean-Luc Godard comme vous l’évoquez précédemment. Est-ce qu’il est important pour vous de représenter la lutte ouvrière de manière intergénérationnelle ?
Claude : Parfois, on a l’impression que c’était un autre temps, mais on se rend compte qu’il y a en fait beaucoup de comparaison à faire avec les sociétés d’aujourd’hui. En ce sens, le premier film de la journée Afrique du Sud Come Back Africa est très important. Car bien qu’il soit réalisé par un Américain, il est considéré comme le premier film sud-africain de l’histoire et permet de retracer ce que pouvait être la situation dans l’Afrique du Sud sous apartheid pour un ouvrier noir. Celui-ci essaye de passer de travailleur agricole à ouvrier en ville. C’est intéressant pour constater les séquelles de cette époque que l’ont voit encore aujourd’hui en Afrique du Sud, même si l’apartheid n’existe officiellement plus.
Tous les ans, vous consacrez une journée à un cinéaste. Cette année, c’est le réalisateur israélien Nadav Lapid qui sera présent pour présenter une partie de sa filmographie. Pourquoi était-ce un choix intéressant pour cette 20ème édition des Rencontres de la classe ouvrière c’est pas du cinéma ?
Claude : Nous voulions proposer une journée avec un réalisateur ayant développé sa carrière sur les vingt dernières années, pendant les Rencontres. Ça fait aussi partie des clins d’œil à cette vingtième édition. Il y a quelques noms qui sont apparus, dont celui de Nadav Lapid qui est un cinéaste qui questionne sa société. C’est ce qui nous a donné envie de l’invité.
Jean-Pierre : C’est aussi un cinéaste relativement jeune, il apporte un nouveau souffle bienvenu.
Certains choix de votre programmation comme la présence de Nadav Lapid ou la projection en avant-première de Bye Bye Tibériade de Lina Soualem trouvent un écho avec l’actualité internationale. Qu’est-ce que cela raconte ?
Claude : Ça nous a confortés dans l’idée de se dire que c’était les bons choix. Nadav Lapid produit un cinéma qui questionne sa société et son fonctionnement. Ce qui en Israël – d’après les interlocuteurs divers et variés que nous avons là-bas – est de moins en moins possible à la suite du massacre du Hamas du 7 octobre.
Jean-Pierre : pour Bye bye Tibériade, ce qui est intéressant avec ce film, c’est qu’il ne place pas son discours politique au centre de son récit. En tout cas, pas autant que d’autres films comme Yallah ! Gaza qui est passé il y a quelques semaines à l’Utopia. C’est avant tout l’histoire de cette famille qui, sur quatre générations, a vécu cet exil (palestinien, ndlr). Il y a la mise en perspective d’une dégradation en la montrant à travers cette histoire familiale.
La journée de samedi sera consacrée à la situation des femmes en Iran. En quoi est-ce que la question de l’indépendance des femmes est un combat jumeau à celui des travailleur·euses, en Iran ou ailleurs ?
Claude : Aujourd’hui, la question de l’indépendance des femmes est davantage acceptée dans la lutte ouvrière. Il y a une époque où l’on pouvait entendre des choses comme « La lutte ouvrière d’abord ! La situation des femmes s’améliorera quand celle des ouvriers aura changé ». Mais depuis les années 1970, les choses sont plus claires, on peut être opprimé·es de différentes façons. Ce n’est pas contradictoires ; au contraire, ça se cumule. Quand on est une femme ouvrière, on est à la fois confronté à toutes les difficultés du marché du travail, mais en plus aux discriminations qu’il peut y avoir vis-à-vis des femmes.
C’est une journée qui fait aussi écho au mouvement de révolte qu’il y a eu ces derniers mois en Iran, dans lequel les femmes ont joué un rôle très important. On l’a vue en Iran, mais aussi dans d’autres pays d’Amérique Latine ou des manifestations sur des sujets comme l’avortement ou le féminicide on permit qu’un mouvement social important s’élargisse. La situation actuelle en Iran est vraiment un exemple de cela. Tout part de l’assassinat d’une jeune femme parce qu’elle ne portait pas bien le voile selon la police islamique. Puis c’est toute la société qui s’embrase.
Vous sortez également le tome 2 de La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Que pourra-t-on retrouver dans ce nouvel ouvrage ?
On avait déjà fait un livre pour les dix ans « des rencontres », constitué de courts articles réalisés par des cinéastes invité·es, des spectateur·ices, des membres de l’équipe, des militants syndicaux associatifs, des chercheur·euses. Nous avions sollicité beaucoup de personnes…
… qui ont participé aux Rencontres ?
Claude : Oui. Et pour les vingt ans, on s’est dit qu’il fallait recommencer. L’idée a donc était la même que pour le premier tome. Et on se retrouve donc avec un livre constitué de trois volets. Le premier autour de ce que sont les rencontres. Un second, autour du travail. Et un dernier qui s’intitule « des films et des réalisateurs ». Nous avons des formes différentes, avec des articles plus ou moins longs. Nous avons, encore une fois, sollicité un certain nombre de personnes, et puis il a fallu mettre tout ça en forme. C’était un travail lourd, avec beaucoup d’écriture, les choix de mise en pages, de photos…
Jean-Pierre : C’est un livre assez éclectique puisque parmi ceux qui écrivent il y a des universitaires, des réalisateur·ices… C’est donc une écriture diverse avec des regards qui le sont aussi. Ce n’est pas un ouvrage académique avec des témoignages formatés.
C’est un projet qui est soumis à la capacité de l’équipe de se renouveler.
Claude Darmanté
Le tome 3 dans dix ans ?
Claude : Du fait de ce que nous sommes, nous ne savons pas du tout combien de temps les Rencontres pourront encore durer. Tout repose sur une équipe de bénévoles avec ce que ça veut dire : il y a un certain nombre de personnes qui nous ont quittés pour diverses raisons, d’autres qui sont arrivé·es…
C’est un projet qui est soumis à la capacité de l’équipe de se renouveler. Est-ce que c’est une proposition qui va encore fonctionner à l’avenir ? On n’en sait rien, le monde change. Même au sein de l’équipe il y a des questionnements « est-ce que l’on reste sur une semaine par an ? Est-ce qu’on passe sur un rythme d’une projection une fois par trimestre ? » et nous allons discuter de nouveau pour l’édition suivante. Ce n’est jamais quelque chose d’inscrit dans le marbre.
Oui, on imagine qu’en créant les Rencontre il y a vingt ans, vous n’imaginiez pas être encore là vingt ans après…
Jean-Pierre : Il y a une question générationnelle : nous somme quand même une équipe où nous ne sommes plus vraiment des « perdreaux de l’année » pour la plupart d’entre nous. Même si on a un public diversifié en termes d’âge – nous avons un partenariat avec l’université Bordeaux Montaigne -, au sein de l’équipe, c’est une autre question.
Claude : L’équipe se renouvelle, mais pas assez. Beaucoup de gens viennent aujourd’hui dans l’association avec l’idée d’un projet, mais se désintéressent ensuite du reste. Et pour ce qui est des plus jeunes, il y en a beaucoup qui quittent Bordeaux, souvent à partir du moment où ils ne sont plus étudiant·es.
Jean-Pierre : Les conditions ont beaucoup changé. Dans notre génération, il y avait peut-être davantage de stabilité professionnelle et géographique. Désormais, lorsque les études sont terminées certain·es partent à Paris, à Strasbourg, à Singapour…
Claude : On le constate avec les jeunes universitaires avec qui nous travaillons, qui étaient à Bordeaux et qui sont parti·es, parce qu’ils ou elles avaient un poste de professeur·e à l’autre bout de la France par exemple. Tout ça fait que ce n’est pas forcément évident de renouveler nos membres.