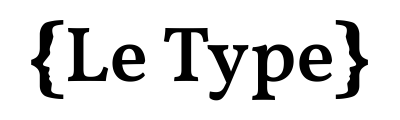Rencontre avec la danseuse et chorégraphe Betty Tchomanga, à l’occasion de la représentation de Mascarades à Trente Trente. Une chorégraphie proposée dans le cadre du festival de la création courte, à la Halle des Chartrons le samedi 21 janvier.
Deuxième semaine pour Trente Trente, le festival de la forme courte, hybride et pluridisciplinaire. Samedi 21 janvier, à la Halle des Chartrons, sera joué Mascarades, un solo de Betty Tchomanga, danseuse et chorégraphe ayant fait ses premières armes au Conservatoire de Bordeaux. Mascarades, c’est une alliance entre contrainte physique et variations de masques, pulsations rythmiques et visages-images. Dans cet entretien, Betty Tchomanga parle du mythe de la déesse Mami Wata, dont elle s’est inspirée, de son processus de création, de rythmes et de circulation des imaginaires.
Le Type : Pour composer Mascarades, tu t’es inspirée de la figure de Mami Wata, déesse africaine des eaux, issue des bas-fonds de la nuit, symbole de pouvoir et de sexualité. Comment l’as-tu découverte ?
Betty Tchomanga : Je l’ai découverte lors d’un voyage au Cameroun dans ma famille paternelle, au moment des fêtes de fin d’année. A cette période, beaucoup de récits circulent, notamment au sujet de la mer, et c’est aussi l’époque où Mami Wata sort. En posant quelques questions à son sujet, j’ai compris qu’on en a fait une sirène, associée à la beauté, au pouvoir, à la sexualité et à l’argent, mais que l’on considère aussi comme une monstruosité dont il fallait se méfier.
À mon retour en France, j’ai poursuivi mes recherches, et je suis tombée notamment sur des études anglo-saxonnes, qui parlent de Mami Wata comme d’une figure post-coloniale. Selon ces études, elle viendrait d’un mélange entre des représentations de sirènes, que l’on trouvait sur les proues des bateaux des colons, des croyances en des esprits des eaux, et des images de charmeuses de serpent, qui viendraient plutôt d’Inde, et qui ont circulé sur le continent africain via le commerce triangulaire. Ce qui m’a intriguée et a résonné chez moi, c’est cette idée d’une figure associée à l’histoire coloniale et qui fait l’objet de circulations, de croyances.
Mami Wata symbolise à la fois la beauté et la monstruosité, soit une laideur symbolique. Comment cette ambivalence se traduit-elle dans ta danse ?
Elle se traduit surtout par le travail du masque, qui donne déjà son titre à la pièce (« Mascarades »), et qui renvoie lui-même à un travail sur le visage. Toute la danse de Mascarades est construite sur une dissociation entre le bas et le haut du corps. Le bas du corps est très fonctionnel puisqu’il va servir à sauter. Quant au haut, c’est la partie où vont surgir des images, des figures, des émotions, et par laquelle passent potentiellement des bribes de récits.
Surtout, ce qui m’a le plus intéressée dans ma chorégraphie, c’était de travailler sur l’entre-deux images, c’est-à-dire tout ce qui peut apparaître entre deux images.
Betty Tchomanga
Mami Wata est un monstre aussi dans le sens où c’est une créature hybride, mi-femme mi-sirène. Par cette idée d’hybridité, on toucherait à la problématique très contemporaine de l’identité multiple et de la fluidité des genres. Comment cette question-là est-elle abordée dans ta danse ? Par cette multitude de visages que tu fais surgir justement ?
Oui, notamment. Il y a l’idée d’un puits sans fond dans ma danse : c’est comme si la pulsation, le saut, provoquait une oscillation à partir de laquelle peut surgir une infinité d’images. Surtout, ce qui m’a le plus intéressée dans ma chorégraphie, c’était de travailler sur l’entre-deux images, c’est-à-dire tout ce qui peut apparaître entre deux images.
Ta danse est faite uniquement de répétitions de sauts, qui sont comme des impulsions organiques. Comment naissent-elles dans ton corps, précisément ?
Elles naissent à partir du centre du corps, du ventre. La pulsation est aussi très connectée au souffle, donc à la voix. En fait, il y a deux fils qui se tirent tout au long de la pièce. D’une part, il y a celui, très physique, du corps et de la pulsation générée par le saut. D’autre part, celui de cette pulsation connectée au souffle, qui va faire jaillir la voix, et progressivement les mots, jusqu’au chant même.

Justement, ta danse s’accompagne aussi de la voix, que tu ne cesses de moduler (projections de sons gutturaux, ou plus aigus, des bribes de mots, etc). Quelle matière est-elle pour toi, finalement ?
La sirène est associée au chant, dans les mythologies occidentales en tout cas, donc il me paraissait évident que la voix fasse partie de cette danse, de ce corps, de ces figures qui apparaissent. Aussi, toute la dramaturgie vocale s’appuie sur des textes et des chansons existants. Donc la voix n’est pas qu’une matière organique, elle travaille aussi avec des supports qui amènent du sens et du récit.
J’utilise une chanson de Kurt Weill, « The Drowned girl », qui parle d’une chute d’une femme qui se noie et se transforme presque en être des eaux, en sombrant dans les limbes. Je m’appuie aussi sur un texte de Lydia Lunch, « Fuck », qu’elle dit par bribes, donc on ne comprend que des bouts de mots. C’est un texte qu’elle a écrit quand elle était très jeune, qui parle de sang et de sexe, hyper revendicatif et très agressif. À cela s’ajoute un texte de rap, « Libérez la bête »de Casey, qui vient comme un point d’acmé à l’intensité physique dans laquelle je suis depuis le début de la pièce. Et je finis par un chant, « Horses in the sky », de A Silver Mt Zion, qui me permet de ramener les deux mondes ensemble, celui de la figure mythique et celui de l’humaine.

La musique est, quant à elle, faite de rythmes répétitifs. Comment influence-t-elle tes sauts ? Et comment a-t-elle été composée ?
La musique est complètement motrice de cette danse, dans le sens où je l’ai écrite sur cette musique-là. Elle est à la fois un moteur et un support rythmique pour les sauts. Même si je peux amener parfois de légères variations rythmiques, qui se mettent en place d’elles-mêmes d’ailleurs, je ne vais pas chercher à phraser des choses très complexes. Quant à la composition de la musique, ce sont des samples qui viennent de DJ Lag, un DJ sud-africain.
J’utilise un morceau complet et aussi des samples très courts, entre dix et quinze secondes, qu’on (avec Stéphane Monteiro, le créateur sonore, ndlr) a étirés sur plusieurs minutes, ce qui accentue encore davantage le côté répétitif de cette musique de club. Aussi, tout un travail musical et sonore est fait par Stéphane Monteiro, à partir du moment de la pièce où on sort de cette répétition rythmique.
Symboliquement, il s’agit de partir de l’espace du mythe pour arriver à celui de l’humain et du réel, de la performance, de la communauté créée à chaque représentation.
Betty Tchomanga
Dans ta note d’intention, tu écris ainsi « Sauter pour devenir. Sauter pour être ». Comment s’articulerait alors cette tension entre le côté très organique, terrien, de tes impulsions et ce côté plus métaphysique de la projection, de l’élancement vers quelque chose qui nous dépasse ?
Déjà, c’est le mouvement même qui voudrait cela. S’ajoute aussi l’idée d’être une surface de projection, dans le sens où je laisse mon corps être traversé par des images que je génère. Bien que la chorégraphie soit très écrite, que mon chemin soit très précis d’une figure à l’autre, mon corps se fait aussi réceptacle de tout ce que le public peut voir dans ma danse, de tout ce qu’il peut se raconter. C’est une rencontre de tous les imaginaires qui a lieu, et que je ne maîtrise plus.
Sur scène, on voit une plateforme recouverte d’une sorte de vinyle miroir, qui reflète les lumières. Comment as-tu pensé cette scénographie et sa symbolique?
En fait, c’est une estrade qui forme un îlot ou un autel, selon ce qu’on a envie d’y voir. On a un peu modifié la scénographie au fur et à mesure des dates, mais à l’origine, tout l’îlot était recouvert d’une couverture de survie, ce qui produit cet effet réfléchissant. Maintenant, il n’y a plus que la surface du dessus qui est recouverte et les contours, quant à eux, sont recouverts de noir. Cela produit quelque chose de plus trouble, dans le sens où on ne voit plus très bien d’où provient l’effet réfléchissant.

L’idée de cette scénographie est venue de toutes les images d’autels liées à la divinité Mami Wata. Il y a aussi la volonté de créer une tension entre le lointain et l’espace du public, puisque toute la danse est écrite sur un couloir, qui part de ce lointain et arrive jusque dans le public. Symboliquement, il s’agit de partir de l’espace du mythe pour arriver à celui de l’humain et du réel, de la performance, de la communauté créée à chaque représentation.
Et cet « espace du réel », ce serait aussi ton visage finalement, celui avec lequel tu ne cesses de jouer, que tu théâtralises ?
Oui. En tout cas, il est l’espace du présent. Il est le lieu où je laisse se rendre visible ce qui me traverse.
Tu as créé cette pièce en 2020, il y a maintenant presque trois ans. Comment la danses-tu aujourd’hui ? As-tu perçu des sens nouveaux en elle ?
Autant la pièce a peu changé dans son écriture, autant elle s’est nourrie énormément de toutes les expériences qu’elle a eues depuis sa création. Je l’ai jouée dans des contextes très différents : parfois sur des plateaux, dans des boîtes noires, donc dans l’espace du théâtre, qui propose une forme d’abstraction, et d’autres fois dans des espaces extérieurs, traversés par la lumière du jour, qui ont une histoire, un contexte référentiel. J’ai pu la jouer aussi dans des pays qui n’ont pas le même rapport à la divinité Mami Wata, comme au Bénin ou au Mali.
À chaque fois, cela alimente les différentes couches de lecture que la pièce peut avoir, et permet de faire circuler les imaginaires différemment, suivant si des correspondances se créent ou non entre l’espace et la danse. Le fait qu’elle soit à chaque fois réactivée, qu’elle ne cesse d’évoluer, est important pour moi, c’est ce qui me donne encore envie de la jouer.
Enfin, c’est quoi pour toi le festival Trente Trente ?
Je connais peu ce festival. Je suis originaire de Bordeaux mais cela fait très longtemps que je l’ai quittée. J’ai entendu parler de Trente Trente, mais je n’y ai jamais été, ni en tant que performeuse ni en tant que spectatrice. Donc je suis plutôt dans la découverte, et je suis assez curieuse ! Le format court, sur lequel le festival met l’accent, m’intéresse beaucoup.