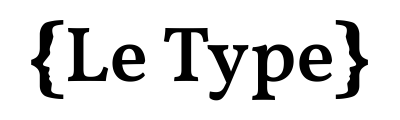Arrivé par hasard dans la musique grâce à des ateliers d’écriture au lycée, Simia développe son univers artistique s’inspirant autant de rock que de rap, ses deux choix de cœur autour desquels il construit son identité. Défendant la décomplexion et le décloisonnement des genres pour cultiver une musique qui se doit avant tout d’être personnelle, l’artiste était de passage à l’IBOAT le 8 décembre dernier avec Nemo. Son parcours, le rôle des réseaux et la scène actuelle : on a pu échanger avec lui.
Le Type : Comment expliques-tu ton introduction dans le monde de la musique ?
Simia : J’ai commencé un peu par hasard avec le rap. J’en écoutais assez peu, mais j’avais une amie qui en faisait dans le cadre d’un atelier, dans une MJC. Je suis allé voir ce que ça donnait et j’ai trop kiffé ! J’avais jamais essayé d’écrire et j’ai tout de suite aimé. J’ai découvert une forme de liberté que je ne connaissais pas : écrire tout ce que tu veux, jouer avec les mots, donner ton avis sur des choses sans forcément être dans le débat, et avoir une forme artistique pour le faire. Mon entrée s’est faite comme ça.
Tu es donc l’auteur de tes textes : d’où est né ce goût pour l’écriture et quelles sont tes sources d’inspiration ?
Elles sont diverses, surtout aujourd’hui où je peux m’inspirer de plein de trucs différents qui ne me ressemblent pas du tout. Par exemple, en ce moment, je me suis pris une gifle sur les textes de Pauline Croze. Je n’écris pas forcément pareil, mais ça m’a inspiré parce que ça lui ressemble et moi aussi, j’essaie de rechercher quelque chose qui me ressemble.
Sinon, à la toute base, c’est vraiment dans le rap des années 1990 et du début des années 2000. Je connais par cœur le premier album d’Oxmo Puccino. C’est la première fois où je me suis dit « Waw, c’est incroyable la manière dont on peut jouer avec les mots et arriver à dire des choses ». Je suis aussi inspiré par un artiste qui s’appelle Rocé, bien qu’il fasse un peu moins de trucs maintenant, mais qui était une grosse figure du rap français dans les années 1990. Fabe, aussi. Quand j’ai commencé le rap, j’ai tout de suite fait mes classes, car je suis revenu 20 ans en arrière pour voir les trucs que j’avais « ratés ». J’ai donc découvert un monde que je n’avais pas vécu ce qui m’a permis de le prendre sans baigner dedans.
J’aime le rap comme un auditeur, mais le truc qui me fait vraiment vibrer, qui me parle, c’est le rock.
Simia
Ta musique mélange les styles, s’affranchit des codes de genres musicaux. Avec une dominante de textes typés rap sur des mélodies plutôt rock, mais pas que… Comment se sont construits ton univers et ton identité musicale ?
Moi, je viens vraiment du milieu du rock. J’ai fait du skate durant toute mon enfance. À l’adolescence, on écoutait beaucoup de rock indie british des années 2000 donc Block Party, Arctic Monkeys, The Strokes ainsi que beaucoup de trucs d’avant, style new wave, cold wave : Joy Division, The Cure... Quand j’ai commencé à faire du rap, c’était l’époque 1995 donc il fallait prouver que tu rappais sur des morceaux des années 1990. Comme je découvrais ce nouveau monde, je me suis mis à faire cette musique puis je l’ai fait évoluer parce que la trap est arrivée et on a commencé à se décomplexer. Dans ce mouvement de liberté, je me suis dit « J’aime le rap comme un auditeur, mais le truc qui me fait vraiment vibrer, qui me parle, c’est le rock. »
Durant le confinement, je me suis retrouvé à re-baigner dans ce qui me touchait vraiment : le rock. Comme j’avais acquis une petite expérience de l’écriture, je n’avais plus besoin de trop me chercher, ce qui a donné ma musique d’aujourd’hui : des morceaux comme « Sextoy », « Du Faux », « Double Tap » qui viennent de sortir. Sur des inspirations électro-punk, un peu indie, british, où je pose ma voix comme un rappeur, mais parfois, je me teste à chanter un peu ou à crier comme sur du punk. J’essaie d’être le plus proche de ce que je suis et ça donne cette musique.
À t’entendre, on a l’impression que la musique t’apporte un vaste champ de liberté. Qu’en penses-tu ? Que représente-t-elle pour toi ?
Principalement la liberté effectivement, mais pas uniquement la liberté de faire. C’est aussi la liberté de penser, de dire. Il y a quelque temps, j’ai commencé à prendre plus position dans mes textes, à être un peu plus engagé sur des sujets qui me tiennent à cœur. J’ai passé une nouvelle étape dans cette liberté, car aujourd’hui, grâce à la musique, je suis plus dans une volonté d’être 100 % moi-même en cherchant qui je suis au fond.
En 2016, tu sors tes premiers clips sur YouTube. Fruit d’un long travail, les visionnages ne cessent de croître alors qu’en parallèle, tu investis les réseaux sociaux, notamment TikTok où tu partages des freestyles qui cumulent des centaines de milliers de vues. Quel rôle jouent les réseaux dans l’émergence de ta carrière ?
Pendant longtemps, c’était un problème, comme pour beaucoup d’artistes, avec qui le débat commence très doucement. Les réseaux, ça nécessite d’être très récurrent et stratégique dans les publications, alors qu’en réalité, notre travail, c’est de faire de la musique. J’ai eu du mal à trouver ma voie là-dessus, car, quand je publiais des trucs, ça ne marchait pas. Puis je l’ai vu comme un terrain d’expression où je pouvais être encore plus pointu sur un sujet et différemment de ma musique.
C’est là qu’est né mon projet de freestyle où je répondais à des vidéos assis sur mes toilettes. Je me suis dit « J’ai des toilettes un peu marrantes. C’est facile à faire de chez moi. Je vais répondre avec ce que je sais faire, c’est-à-dire des punchlines avec de l’énergie et de la musique pour éviter ce côté clash qu’on voit beaucoup et qui ne mène à rien sur les réseaux ». C’est une forme de pacification de la violence la musique. Si on se répond en musique, ça évite de se taper dessus et c’est plus sympa. Ce format ayant plutôt bien pris, cela m’a permis de prendre confiance en moi-même et en ce que je peux dire sur les réseaux. J’ai parfois réfléchi à des contenus qui n’ont même pas fait un tiers du quart de vue de ce que j’ai fait en allant dans mes toilettes. Finalement, je trouve que c’est plutôt une bonne chose, car ça veut dire qu’il faut être soi-même.
On a beaucoup entendu parler de ton concert à la Boule noire, le 27 juin dernier. On retrouve même des images dans le clip de ton récent morceau « L’usine ». En quoi ce fut une date particulière ?
Le concert est la partie la plus importante de ma musique. C’est ce que j’aime faire. J’ai commencé par là, très vite, avec les open mic qui permettent de mettre un pied sur scène alors que tu n’es jamais allé en studio. J’aime le fait de partager un moment avec les gens. J’ai fait beaucoup de premières parties, pendant un temps, ce qui est un bel exercice, car tu dois convaincre, parfois presque conquérir, un public qui n’est pas venu pour toi.
La Boule noire, c’était mon premier concert solo et c’était dans ma ville donc c’était une date à marquer d’une pierre blanche, comme on dit. C’était incroyable, car j’ai rencontré pour la première fois mon public. J’ai jamais vécu un truc aussi fort ! Ça redonne beaucoup de confiance, de bons sentiments à l’égard de ce qu’on fait, qui parfois, pour en revenir sur les réseaux sociaux, est très lointain de la vie réelle parce que t’es beaucoup sur les streams, les shifts… Et en fait, faire des concerts, c’est tout ce qui reste de réel.
Ce soir, c’est mon premier soir à Bordeaux et je suis très content d’aller rencontrer un nouveau public. Je sais qu’il y a des gens qui viennent me voir que je n’ai jamais rencontré de ma vie et c’est trop touchant. J’ai envie de faire les choses bien pour eux.
En effet, tu partages ce soir (l’interview réalisée en décembre dernier, ndlr) l’affiche de l’IBOAT avec Nemo et d’autres dates sont également prévues pour vos tournées en France. Qu’est-ce qui résonne pour toi dans l’univers de cet artiste ?
Il apporte un truc très frais, très nouveau. Moi, j’adore cette vibe complètement décomplexée par rapport aux influences. C’est la nouvelle belle chose que l’on trouve dans la musique aujourd’hui. Tu peux avoir un mec qui dit faire du rap, mais c’est de l’électro derrière. Je pense à Winnterzuko que j’adore et qui le fait très bien. Nemo, je le mets dans cette catégorie d’artistes ultra-décomplexés, qui vont juste te proposer de la bonne musique et qui n’ont pas besoin de te dire que c’est de la variété, du rock… Juste on fait de la musique. Évidemment qu’on a des influences… Moi, je suis passé du rap au rock, mais je ne voulais pas faire le choix de renoncer à l’un pour l’autre. Ça reste un discours et au final, c’est moi à la fin. Mon identité, elle est là !