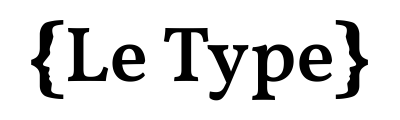L’année 2020 a été éprouvante pour les street artistes de Bordeaux et d’ailleurs, forcé.es de réinventer leur travail. Cette période particulière invite ces derniers à s’interroger sur les difficultés que traverse le secteur artistique plus largement, ainsi qu’à poser la question de l’imbrication de leur pratique dans la ville. Jonas Laclasse, Selor, Delphine Delas, Skou et Odeg font part ici de leur vision sur le contexte actuel et de la façon dont ils envisagent l’évolution de leur art. Une façon de balayer des sujets variés qui concernent leur travail, l’origine du street art, l’environnement dans lequel ils évoluent et le futur de cette contre-culture.
Profusion et enfermement
Si Bordeaux et ses façades colorées regroupent des artistes mondialement connus comme le mystérieux Banksy (bien que la question fasse débat en ville sur la véracité de l’œuvre), elle regorge aussi et surtout de nombreux talents locaux. Artistes, collectifs, lieux d’exposition et festivals bourgeonnent dans Bordeaux et ses périphéries. Certains lieux sont devenus des passages obligés, comme le quai des Chartrons et son skatepark, ou encore les Bassins à Flot avec sa Soucoupe Volante.
Progressivement, associations et collectifs se sont implantés, créant ainsi des lieux d’échange et de partage autour de cet art, par essence anticonformiste. Pour contenter les citadin.es, des festivals ont par ailleurs éclos, comme le Fest’Arts de Libourne, connu à travers toute l’Europe. Une influence qui gagne même les bancs de l’école comme l’explique le street artiste Odeg qui participe à un projet ayant « […] pour but d’intégrer le graffiti street art et son histoire au programme des élèves de troisième ». Un programme qui concerne 160 élèves toutes et tous désireux de « […] comprendre cette pratique au travers de la créativité et des codes qu’elle véhicule ».
Alors que l’art et le street art n’ont jamais été autant appréciés par leurs publics, la Covid-19 est venu stopper net cet élan. Fermeture des lieux culturels, restriction de l’accès aux espaces publics puis confinement ; les artistes et autres graffeur.euses ont cessé d’habiller les murs de la ville. Un contexte qui les coupe de leur espace de création habituel mais qui peut être propice à la réflexion et permet de se concentrer sur des travaux personnels, comme l’indique par exemple Skou : « Mon retour en Grèce, ma terre natale, m’a permis de m’isoler près de la mer et de la nature ce qui m’a donné la possibilité de rester concentré sur mes différents projets artistiques et personnels ».

Cette période de jachère est un moment opportun que chacun occupe à sa manière. Delphine Delas qui a entre autres habillé le Gymnase Thiers (rive droite à Bordeaux) confie ainsi ; « Cela m’a permis de pouvoir mettre en place pleins de choses que j’avais en retard ou que je voulais faire. Prendre le temps aussi c’était pas mal, cela m’a donné un temps de production et de travail de perfectionnement technique ». Selor l’explique aussi en indiquant avoir pratiqué sur « très peu de murs sauvages à Bordeaux cette année ». Malgré tous, les artistes continuent de créer dans leurs ateliers, leurs appartements, à l’abri des regards.
Cette restriction questionne la notion d’occupation de l’espace public pour ces artistes. À l’heure où « […] le contact et la communication humaine sont des liens des plus vitaux mais qui ont été détériorés », comme le raconte Skou, chaque sortie en plein air est savourée et permet aux bordelais.es de redécouvrir le paysage urbain de leur ville.
On ne peut pas comparer l’expérience de contempler une œuvre d’art physiquement à celle de la regarder sur un ordinateur
Delphine Delas
Par ailleurs, la situation inédite oblige les espaces culturels à redoubler d’ingéniosité pour permettre au public de retrouver un semblant de culture. Si le numérique est une solution qui répond à ce besoin, « La visite des musées en visite virtuelle à ses limites ; on ne peut pas comparer l’expérience de contempler une œuvre d’art physiquement à celle de la regarder sur un ordinateur » comme le souligne Delphine Delas pour qui l’enfermement doit se transformer en une période créative et productive.

Les codes du street art
Popularisé dans les années 1970 aux États-Unis, le terme street art fait à l’origine référence à un art anticonformiste. Peu à peu, les œuvres temporaires deviennent des œuvres permanentes, faisant alors du street art un mouvement artistique subversif. Aujourd’hui encore, des clichés gravitent autour de cet art et son interdiction est toujours parfois d’actualité. Skou précise « Les conditions de son expression restent inchangées, il n’a jamais été légal de peindre sur des murs, le street art est jugé par la loi ». Des lieux tentent malgré tout d’encadrer cette pratique, permettant in fine aux artistes de composer dans un cadre réglementé, mais qui pose la question de l’essence même d’un art subversif paradoxalement encadré.
Le confinement est parfois perçu comme une aubaine pour les streets artistes qui pourraient profiter de ce désert urbain pour envahir la ville, comme le souligne Delphine Delas : « C’est le bon moment car il y a moins de circulation dans les espaces, moins de monde ; l’espace public est toujours là, à nous tendre les bras ». Sur le terrain c’est une autre réalité, les artistes s’accordent à le dire, l’habillement urbain a été mis en pause en 2020 et laisse place à un travail invisible.
La ville a besoin de se libérer
Skou
Plus globalement, la rue est un endroit clé d’échange et de rencontre, qui reste très affectée par sa restriction, « La ville a besoin de se libérer » dénonce Skou. C’est un espace libre sans barrière qui permet à chaque artiste d’exposer son travail et de s’offrir une visibilité, comme l’évoque Selor pour qui « Le rôle du street art est d’ouvrir les esprits, montrer le travail des artistes ». Plus qu’un espace d’exposition, il devient un lieu d’émancipation en particulier pour « […] ceux qui cherchent à se faire un nom, ceux qui cherchent à exposer, tout est très incertain, donc la seule option solide pour continuer de montrer son art, c’est ce travail dehors, dans l’espace ». La singularité de l’art libre réside dans son environnement, il est accessible et visible par toutes et tous.

L’art dans la rue prend encore plus de sens et de poids, vu que les institutions sont fermées. Elle seule et les médias maintiennent la culture accessible à tous
Selor
À la différence des galeries et autres espaces de créations, l’espace urbain, bien que réglementé, ne peut pas être interdit comme pour les galeries, les salles de concert, les bars et autres lieux culturels. Cette restriction est l’occasion de reconsidérer l’importance de la rue jusqu’alors boudée par les arts plus conventionnels. En un an, elle est devenue l’hôte idéale pour toutes formes artistiques. « Le rôle du street art ou art urbain justement est de continuer à offrir de l’art dans les espaces publics aux passants, comme il l’a toujours fait » indique Delphine Delas. Un avis partagé par Selor pour qui « L’art dans la rue prend encore plus de sens et de poids, vu que les institutions sont fermées. Elle seule et les médias maintiennent la culture accessible à tous ».
Au bout de la rue
La rupture soudaine entre la rue et les artistes impose un nouveau cadre et suscite de nouvelles idées. Bien que coupé de l’extérieur, Odeg s’est par exemple adapté à son environnement en apportant sa patte à l’appartement d’un ami qu’il occupait « J’ai pendant de nombreux jours décoré les lieux du jardin au salon jusqu’à sa façade située dans une rue de Bordeaux ». Ce contexte inédit, digne d’un « film de science-fiction IRL » comme aime le dire Jonas Laclasse, est une source d’inspiration indéniable chez certains, même si Odeg souligne lui de son côté un certain désarroi face au contexte : « du jour au lendemain, plus personne sur les trottoirs, dans les rues des villes vidées, comme si toutes les œuvres visibles seraient devenues invisibles ».
Depuis mars 2020, on voit ainsi fleurir à travers le monde des œuvres de street art en lien direct avec la pandémie. Delphine Delas a ainsi réalisé deux projets directement en lien avec la crise sanitaire, « J’ai eu ce besoin de production autour de cette thématique d’enfermement ». Une inspiration qui provient de la situation mais aussi des émotions qu’elle procure. Skou évoque la volonté de transposer ses émotions dans ces œuvres « […] c’est grâce à ces sentiments que l’on arrive à créer et apporter l’expression ». Pour l’artiste, l’art en général est une retranscription artistique de la société, « L’art reste et restera notre porte-parole ». Un porte-parole qui, depuis le début de la pandémie, est devenu de plus en plus bavard et davantage écouté.
Avant de savoir quel est le rôle du street art, je me poserai la question du rôle de la culture
Jonas Laclasse
Cette période de crise ouvre le débat sur de nombreux sujets comme la question du rôle de la vie culturelle. Selon Jonas Laclasse, « Avant de savoir quel est le rôle du street art, je me poserai la question du rôle de la culture » et poursuit « J’ai eu un gros passage à vide niveau trésorerie à la rentrée ». Odeg a lui traversé des déceptions sur le plan professionnel « Du jour au lendemain tous mes projets et expositions en cours se sont dissous ou ont été reportés ». Des difficultés qui manifestent le besoin pour le secteur culturel et ses acteurs de bénéficier de moyens plus importants, mais aussi d’un soutien autre que financier. Malgré un art urbain mis en pause pendant toute une année sur Bordeaux, les projets privés sont nombreux, comme pour Selor, « J’ai passé mon année à faire des commandes de toiles, des projets de murs privés. Les besoins d’évasion des uns et des autres, les confinements ne m’ont pas apporté repos, et j’en suis vraiment heureux », une demande qui parle d’elle-même.
Parmi toutes les questions que soulève la pandémie, on retrouve tout en haut de la pile la volonté de valoriser l’art et l’espace urbain. Pour l’art, un grand nombre de personnes ont rouvert leurs tiroirs pour ressortir pinceaux et crayons et ainsi occuper leurs journées à huis clos. Pendant le confinement sur les réseaux sociaux, des pages ont organisé des concours de dessins pour occuper une population confinée via l’apprentissage artistique. Odeg a par exemple participé au « graffiti Xchange » qui, chaque jour, rassemblait des centaines de graffeurs ou illustrateurs à travers le monde. Un intérêt grandissant pour l’art qui pourrait révéler des passions chez certain.es comme le questionne Skou « Qui sait ? Certains attraperont peut-être un pinceau et décideront de s’exprimer sur une toile ou sur les murs de leurs villes ». Concernant le lien à l’espace public, les street artistes bordelais.es soulignent l’importance pour les habitant.es et les artistes de la rue de se réapproprier ce lieu. « Cette expérience peut tout de même être bénéfique pour beaucoup en reconsidérant leurs liens avec la ville », interroge Skou. « Les bancs publics disparaissaient de plus en plus », un exemple pour Jonas Laclasse montrant la rue comme un espace peu à peu délaissé. En attente de réponses à toutes ces questions, les artistes eux brûlent d’envie de retrouver leur terrain de jeu, la rue.