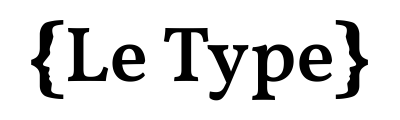I Am Stramgram, c’est le projet de pop hybride et lunatique de Vincent Jouffroy qui a déjà quelques EP et deux albums à son actif, dont When the Noise Becomes Too Loud, qui a vu le jour le 9 octobre dernier. Au lendemain de sa sortie, on a pu échanger avec cet artiste aux multiples facettes pour parler de ses inspirations musicales et artistiques, de son processus créatif et de la portée de son tout nouvel album.
Le Type : Salut Vincent ! Déjà, pour commencer ; comment ça va ?
I Am Stramgram : Euh, je ne sais pas… J’ai l’impression d’être super schizophrène avec tout ce qui se passe, c’est un peu triste, toutes les dates sont annulées, c’est extrêmement dur de travailler à l’heure actuelle. Il n’y a plus de scène, plus d’endroit où on peut réunir les gens, plus d’endroit où on peut faire de la musique donc bon… Je ne sais pas si ça va très bien… mais ça va passer !
Tu as sorti ton premier EP en 2012 Let’s not run the race, mais avant ça, depuis combien de temps faisais-tu de la musique ?
C’était il y a super longtemps ! J’ai commencé comme tous les ados, en 4ème, j’avais les cheveux longs et gras, des boutons partout. J’écoutais pas mal de musique quand j’étais au collège : j’avais des grands frères qui avaient des potes qui étaient vraiment des « boulimiques de musique », donc j’ai commencé à récupérer des choses qu’eux-mêmes écoutaient. Du coup, j’y suis venu comme ça, à vouloir faire de la musique, à vouloir en découvrir un peu plus. Le tonton de mon meilleur pote lui avait donné une guitare, et on a commencé à jouer tous les deux, on a formé notre premier groupe qui s’appelait « Edelweiss », on devait avoir genre 14 ans.
Chaque écoute, chaque album, c’était une écoute hyper concentrée et intense qui m’a beaucoup influencé.
Nous avons fait les premiers concerts en 4ème ou 3ème, et c’est comme ça que j’ai commencé à faire de la musique. C’était vraiment lié aux trucs que j’écoutais à l’époque, je ne veux pas parler comme un vieux, mais l’accès à la musique était quand même un peu plus délicat. On n’avait pas internet, il n’y avait pas internet chez moi non plus, et tous les CDs qu’on avait, toutes les écoutes qu’on faisait, nous menaient vraiment à prendre le temps de se plonger dans les choses. Chaque écoute, chaque album, c’était une écoute hyper concentrée et intense qui m’a beaucoup influencé.
Qu’est-ce que tu écoutais à l’époque ?
En 1996 est sorti le tout premier album de Placebo qui m’avait beaucoup marqué, ça doit faire 10 ans que je n’écoute plus ce que font ces gens-là, mais les deux premiers albums sont excellents. Il y avait cette espèce de truc post-ado, vachement vener (énervé, ndlr) que j’aimais bien. En 1997, il y a eu OK computer de Radiohead qui était une méga révélation, mélange de pop, rock, de truc triste, hyper bien écrit, et ça me parlait bien. J’écoutais pas mal de rap aussi à l’époque, Iam, L’école du micro d’argent, un album qui m’a vachement marqué. Les influences bougent un peu avec le temps mais c’est toujours des choses que j’écoute de temps en temps.
Les influences que tu cites sont plutôt rock et rap. Quand est-ce que tu as commencé à t’intéresser à la pop et à la musique folk ?
En fait, ce sont des genres de musique qui sont hyper poreux. Pour moi, Radiohead, ils font aussi bien de la pop, que de l’électro ou du rock. Plus ça va, plus les genres sont poreux. On parle beaucoup de « hip pop ». C’est un terme qui à l’heure actuelle a tout son sens : aujourd’hui, on trouve des choses sur des beats un peu urbains, mais avec des textes et limite un flow variété. Donc je ne sais pas, j’écoute beaucoup de choses différentes, et ce n’est pas la musique qui m’influence le plus, ça peut être des séries, des films, des bouquins, des BD…
Passer du jeu en groupe à une carrière solo est-il quelque chose qui a été compliqué pour toi ?
J’adore la solitude autant que j’aime mes amis proches, c’est très paradoxal. En fait, j’ai besoin des deux. J’ai besoin de mener des idées jusqu’au bout, même si je me trompe. J’ai besoin d’essayer d’attraper cette espèce de petit truc que j’ai dans la tête en me disant « il faut que j’arrive à atteindre ça ». J’ai besoin de ne pas faire de concessions et ne pas me perdre dans des conversations avec d’autres gens qui peuvent durer des jours pour essayer de couper la poire en deux.
J’ai besoin de ce travail à plusieurs où tu échanges, où tu explores les choses différemment.
Et d’un autre côté, j’adore travailler en groupe, j’ai toujours des groupes plus ou moins en sommeil, mais ça fait longtemps qu’on n’a pas fait des choses ensemble. Par contre, je travaille beaucoup en groupe pour ce qui est du théâtre. J’ai besoin quand même de ce travail à plusieurs où tu échanges, où tu explores les choses différemment. Ce ne sont pas deux opposés, ce sont deux fonctionnements dont j’ai besoin pour avoir un pseudo-équilibre. Par concours de circonstances, je fais pas mal de musique tout seul, mais c’est aussi car j’aime bien travailler à la maison dans le petit studio.
Après, il y a des trucs très pragmatiques à l’heure actuelle qui sont liés à l’économie et au coût plateau : c’est extrêmement difficile de tourner quand tu es un artiste modeste comme moi par exemple. Quand tu es plus de trois ou quatre en tournée, ça commence à devenir cher en concert. Plus nombreux vous êtes au plateau, plus c’est difficile de tourner, enfin dans nos réseaux… Des rockstars absolues n’ont pas ce problème. Ça fait partie des considérations : j’ai une formule solo, une formule duo, et parfois, on part avec un technicien son. Donc à l’heure actuelle, je suis plutôt sur de la musique en solo, et pour ce qui est des autres domaines, ce serait plutôt un travail collectif.
Tu as suivi une formation en médias et cinéma. Qu’est-ce que ça t’a apporté musicalement ?
J’ai fait la fac d’arts du spectacle à Bordeaux, puis je suis parti en Australie un an faire un master de New media art. Puis, je suis revenu faire le master cinéma documentaire et valorisation des archives à Bordeaux. J’ai toujours adoré l’image, parler de l’image, y réfléchir, en questionner les formats. Par contre, moi, faire des images, je ne suis pas très fort en la matière. C’est quelque chose qui m’intéresse. On me dit souvent que je fais de la musique assez « cinématographique ». Je ne pense pas que ce soit ma formation à l’image qui m’ait amené à faire de la musique qualifiée comme tel, mais je pense que c’est cette sensibilité à la cinématographie qui fait que ma musique ressemble à ça.

Pourrait-on voir une référence au tableau Ophélie de John Evrett Millais dans le visuel de ton nouvel album When the Noise Becomes Too Loud ? Est-ce une façon de donner le ton de ce disque ?
C’est hyper cool que tu parles de ça, la pochette de l’album est un tableau réalisé par Guillaume Montier, qui est le cousin de ma belle maman. Je réfléchissais à la pochette, une fois que les morceaux ont été écrits, et il y avait un espèce de fil rouge dans ce disque qui était le manque d’oxygène, aussi bien dans son côté salvateur que dans son côté étouffant. C’est-à-dire que j’ai tendance à être un peu étouffé par le monde actuel, le rythme, le « trop d’informations », et à la fois j’adore être dans une piscine, faire de l’apnée et manquer d’oxygène. Dans ce contexte-là, je trouve que c’est le truc plus reposant au monde. Du coup, ça m’intéressait d’étudier ce paradoxe lié à la même sensation, mais dont le sentiment qui en découle est extrêmement différent. Ce tableau de Guillaume Montier, avec ce type la tête dans l’eau, c’était vraiment à l’image de ce que véhiculaient les morceaux.
On a rapidement fait le rapprochement avec le tableau Ophélie, et en fait le titre de l’album a failli être « Noyé », qui a aussi un lien avec le tableau de John Evrett Millais, car c’est vraiment l’image qu’il renvoie. On a décidé de ne pas l’appeler comme ça, plutôt When the Noise Becomes Too Loud, parce que « noyé », on trouvait ça trop explicite. Mais on a pensé à ce tableau. Parfois, j’écris les morceaux, et je ne sais pas s’il va y avoir un lien entre eux. Et c’est quand je regarde de l’extérieur, je commence à avoir quinze morceaux, j’ai l’impression qu’il y a un fil rouge. Puis je me demande comment est-ce que je pourrais essayer de résumer, de croquer les morceaux de l’album en une seule image. Ça s’est retrouvé comme ça, je reparcourais les tableaux de Guillaume Montier et je me suis dit : c’est celui-là, il faut que je lui demande l’autorisation pour l’utiliser.

Pour caractériser ton précédent album, Tentacles, tu parles d’un « patchwork » pop/folk/électro. Est-ce que l’on retrouve cette notion dans ton nouvel album ?
Je pense qu’il est moins « éclaté » que le premier dans le sens où Tentacles a quand même pas mal été enregistré sur le long terme, à des moments différents. Là, ce disque a été composé de manière très espacée aussi : les morceaux ont été écrits sur deux ans à peu près. Par contre, il a été enregistré d’une traite. Donc même si tu as des morceaux qui chialent, à la folk, très lyriques, et des morceaux électro qui sont un peu plus physiques, où tu as plus envie de bouger, l’essentiel de l’album est plutôt mélancolique. C’est un créneau dans lequel j’aime bien me situer, mais ce n’est jamais constamment majeur. Je pense qu’il y a une certaine unité dans la production du disque qui peut être différente du premier album, lui qui a été enregistré de manière plus fractionnée.
Aujourd’hui, tu qualifies ton style de « pop lunatique ». Comment expliques-tu ce terme ?
Je trouve que pop, c’est l’appellation la plus large possible, donc je continue à appeler ça de la pop. C’est aussi bien Madonna que les Beatles, donc tu peux à peu près tout mettre dedans. Lunatique, parce que c’est dans mon tempérament de faire de la musique au feeling, de changer d’humeur et faire un peu comme je veux. Il y a encore un côté un peu lunatique par rapport à l’esthétique musicale, dans le sens où il y a des morceaux très intimistes et des morceaux électro plus denses. Donc c’est pareil, c’est un peu à l’humeur.
Justement, de ton point de vue, est-ce qu’on peut retrouver des morceaux plus gais dans ton album, jouant ainsi sur l’aspect lunatique de ta musique ?
Je ne sais pas s’il y a beaucoup de morceaux gais, comme l’album était sur ce truc de manquer d’oxygène. Sur le précédent album, il y avait un morceau qui s’appelait « Underwater Tank », qui évoquait la fin du monde. Les premiers titres que j’ai écrits pour le deuxième disque ont suivi « Underwater Tank » de plusieurs mois, mais j’avais continué à explorer cette thématique de fin du monde, pas forcément de manière triste, c’était un peu par concours de circonstances. Je lis beaucoup de BD, et bon, la référence n’est pas géniale parce que c’est Titeuf et je n’en suis pas du tout fan. Mais il y avait une planche sur laquelle il allait à l’école, puis il sortait de l’école et il y avait un bombardement. En fait, j’ai trouvé cette planche très forte parce ça montrait que ça peut nous tomber dessus comme ça, d’un coup ça devient hyper concret dans ta vie. On en parle aux journaux, c’est hyper lointain, tu sens qu’il se passe un truc, et il y a cette surprise de voir que ce n’est pas si lointain. Il y a aussi des morceaux qui parlent de ça, donc je ne pense pas que l’album soit particulièrement joyeux, mais ne je pense pas qu’il soit triste pour autant. La mélancolie, c’est aussi ce fil tendu entre les deux. J’espère en tout cas que l’album joue sur cette note-là.
Dans des morceaux comme « Saut de ligne » de l’EP Lets not run the Race ou « A million years », un single extrait de When The Noise Becomes Too Loud, on remarque que tu mélanges langue anglaise et française, parfois durant un passage très court. D’où provient cette volonté ?
C’est un truc d’écriture que je ne réfléchis pas forcément. En fait, il y a quelque chose que j’aime bien dans le mélange des langues. Je suis très attaché à la langue anglaise, j’aime bien comment on peut la manipuler, la maltraiter, et c’est une langue qui a la chance d’être très chantante. Il y a ce truc qui coule de source par rapport à la musique pop/rock, cette complémentarité de la mélodie de langue anglaise avec cette esthétique-là. Moi, j’aime bien emmener quelque chose de très concret dans mes chansons, comme si ça te prenait un peu par surprise, comme si tu te laissais porter par la mélodie et d’un coup tu as un sens qui arrive. C’est pour ça que je trouve ça dur d’écrire uniquement en français, parce que tu attrapes le sens, avant d’attraper le son. Les images sont claires, ça rend le texte et le sens très frontaux. J’aime bien jouer avec ça : tu te laisses porter par une mélodie et d’un coup tu choppes du sens, tu reviens sur les paroles, et tu essaies de lier tout ça. Il y a une espèce de surprise et complémentarité que j’aime bien dans cette écriture-là.
Quelle est ta relation avec la scène locale ? Comment te sens-tu en tant qu’artiste évoluant à Bordeaux : y-a-t-il assez de structures qui vous accompagnent et soutiennent la scène artistique plus globalement ?
On va être honnête, on n’est jamais à 100% content de ce qu’on a. On aimerait toujours avoir plus de moyens, de structures… Pour ma part, à chaque fois que j’ai voulu travailler, rencontrer des salles avec lesquelles créer des projets, je n’ai jamais eu de problème pour que ça se fasse. Tu prends du temps pour les rencontrer et si t’arrives avec une pensée construite, un projet, une envie… Ça fait longtemps que je travaille à Bordeaux, avec les salles locales, et ça n’a jamais été un problème. J’ai toujours trouvé que les interlocuteurs que j’avais en face de moi étaient accessibles et réceptifs aux projets qu’on essayait de monter avec les copains lorsqu’on faisait de la musique.
Il y a plein de choses super belles à Bordeaux, plein d’artistes super talentueux qui me collent des branlées tous les jours, plein d’endroits chouettes.
Après, c’est toujours la même chose, lorsqu’il s’agit de SMAC (Salles de Musiques Actuelles, ndlr), avec des moyens, c’est quand-même hyper cool, mais quand c’est des lieux un peu plus indépendants, qui marchent avec leur propre trésorerie, qui n’ont pas de subventions ni aides, pour une période comme aujourd’hui, c’est quand même ultra difficile. Après, ça ouvre la discussion sur un thème plus large que ça, il y a aussi le problème de l’activité d’une ville comme Bordeaux où, plus ça va, plus ces lieux-là sont chassés du centre parce que ça fait du bruit, ça gêne les riverains. L’équilibre n’est pas facile à trouver, mais je pense qu’il y a plein de choses super belles à Bordeaux, plein d’artistes super talentueux qui me collent des branlées tous les jours, plein d’endroits chouettes. Et je pense qu’on pourrait toujours faire mieux, malgré tout.
Après la sortie de cet album, as-tu des dates prévues pour des concerts et d’autres projets à venir ?
Tout est annulé ! La tournée de cet été est passée à la trappe, on devait partir au Canada. Pour l’instant on n’a aucune certitude. J’ai quand même du boulot avec le théâtre, mais les concerts me manquent énormément, c’est ce que je préfère dans la vie. Mais bon, je me dis qu’il ne faut pas être triste car j’ai un toit et je mange des pâtes, il y a plus malheureux que moi. C’est qu’une mauvaise période, qui va passer, j’espère. Musicalement, j’ai commencé à enregistrer un nouveau disque, parce qu’avec la période du confinement, j’ai eu du temps pour écrire. Pour ce qui est du théâtre, je monte un spectacle qui s’appelle Vivarium, un spectacle pluridisciplinaire via la compagnie Fais et rêve qui parle du travail et de la quête de sens. Il nous reste 6 semaines de création, la première est au théâtre de Gascogne le 9 mars 2021, il y a une tournée après. Je fais aussi les musiques d’un spectacle qui s’appelle Phèdre pour la compagnie Jean-Luc Ollivier.

Pour finir, de manière générale, quelles sont les œuvres artistiques qui inspirent ta musique ?
En fait ça dépend vraiment des jours. Des fois, ça va être un bouquin : je lis beaucoup de BD et parfois ça peut m’inspirer. J’étais un grand fan de Fanté, la chanson « Camilla » sur mon premier album a été inspirée par son livre Demande à la poussière que j’avais adoré. « Saut de ligne » était inspirée de Karoo. Pour ce qui est du nouveau disque, il y a eu beaucoup la BD, mais celui-ci est peut-être un peu plus introspectif, un peu moins puisé dans des références extérieures. En matière de musique, j’ai des sources d’inspirations qui me suivent toujours. Je suis un grand fan de Sufjan Stevens, qui va sortir un nouvel album. J’aime bien aussi m’asseoir dans un coin et regarder les gens. Ça rejoint un peu cette dimension contemplative, la musique cinématographique, j’aime bien être spectateur des choses, je trouve ça très inspirant.
)
- Suivre I Am Sramgram sur les réseaux
- Son album When the Noise Becomes Too Loud disponible sur les plateformes d’écoute