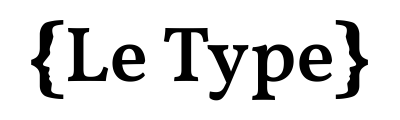À l’occasion de sa venue à l’IBOAT le 17 décembre, nous avons pu nous entretenir avec Flore. DJ, formatrice, productrice et fondatrice du label Polaar, l’artiste lyonnaise interroge ce qui se joue sur la scène musicale électronique en terme de représentations, d’enseignements et d’ambition. Flore prône la non-conformité en cultivant une musique qui se doit de rester personnelle. Dotée d’un savoir-faire qui lui a value d’être la première femme en France à être certifiée Ableton Live, elle enseigne désormais, tout en pratiquant l’art rare d’oser une musique qui regarde droit devant elle. Entretien fleuve.
Le Type : Tu joues le 17 décembre à l’IBOAT pour une « label night » dédiée à ton label Polaar que tu as créé en 2014. Pourquoi avoir voulu le lancer initialement et qu’entends-tu défendre à travers lui, à la fois sur le plan artistique et aussi plus globalement par rapport à l’état de la scène électronique actuelle ?
Flore : Cela faisait déjà un moment que j’avais envie de créer mon label. Pour être autonome et avoir la main sur les sorties de mes propres productions, ainsi que sur mon agenda. Depuis une bonne quinzaine d’année, c’est assez difficile de trouver des labels pour te produire. Quand tu en trouves un, tu es alors très dépendant·e de leur agenda à eux. Parfois, tes morceaux sortent donc un an plus tard. J’étais frustrée de cette situation-là, parce que j’avais vu comment cela fonctionnait. Ensuite, je voulais avoir la main sur ce qu’on allait faire au sein du label. Choisir les pochettes, les gens avec qui travailler, communiquer… J’ai eu envie de signer d’autres artistes, de composer une sorte de famille musicale autour de moi.
En termes d’esthétiques, Polaar correspond à ce que je défends depuis que j’ai commencé ma carrière. Ça va faire vingt ans que j’ai commencé mon travail de DJ, et je suis une amoureuse de ce qu’on qualifie aujourd’hui de bass music. J’en ai une conception très large, qui peut aller du dancehall à 80 BPM (battements par minutes, ndlr) à des morceaux d’Afrique du Sud qui montent à 190 BPM. Il n’y a pas vraiment de notion très précise en matière de vitesse. L’ADN commun du label, c’est une sorte d’obsession pour les rythmiques et la percussion. J’estime que les mouvements contemporains les plus intéressants viennent d’Afrique, aussi bien du Nord que du Sud, mais aussi d’Amérique Latine, d’Inde ou d’autres pays d’Asie.
Les territoires qui n’étaient initialement pas du tout sur le devant de la scène électronique proposent à mon sens les musiques les plus excitantes.
Flore
Les territoires qui n’étaient initialement pas du tout sur le devant de la scène électronique proposent à mon sens les musiques les plus excitantes. Les artistes qu’on signe sur Polaar sont vraiment des artistes qui ont une patte très distincte les uns des autres. On a par exemple SNKLS, basé à Clermont, qui est vraiment axé electronica, aux sonorités très breakées, un peu froides. Alors que Tim Karbon va davantage composer avec des percussions plus organiques. Esther, elle, a un background plus industriel. L’ensemble des artistes ont donc leur identité, mais évoluent dans une famille musicale commune.

Au-delà des soirées que tu organises et des différents événements auxquels tu es conviée en tant que DJ ou productrice, tu cultives beaucoup d’activités : professeure, formatrice, fondatrice de label comme on l’a dit… Comment envisages-tu ton rôle et tes « missions » à travers ces différentes casquettes ?
La partie éducation est arrivée un petit peu par hasard dans ma vie. Cela faisait quelques années que je donnais des cours sur Ableton Live. En 2016, il y a eu cet appel à candidature pour la certification de ce logiciel de production musicale. Il y avait une soixantaine de candidature et, à la fin, on était cinq. Lorsqu’on m’a annoncé que j’avais eu la certification, on m’a également dit que j’étais la première femme en France à l’avoir obtenue !
Je n’étais pas très étonnée parce que cela faisait longtemps que je me sentais assez seule dans ce milieu. Certes il y a toujours eu des femmes dans la musique, mais très peu dans les esthétiques sur lesquelles j’évoluais. Quand tu fais de la musique depuis un certain temps, c’est donc presque quelque chose que tu intériorises, auquel tu ne penses même plus. Inconsciemment, je savais que j’allais être la seule à passer la certification. Mais je n’avais pas réalisé que je serais la seule à l’avoir obtenue en France ! Donc je n’étais pas tant surprise que ça, mais en même temps j’étais très heureuse d’un point de vue symbolique.
Aussi, je suis autodidacte et il y avait une sorte de validation des acquis. Ça faisait du bien. Quand ça s’est su, ça a fait beaucoup de bruit. J’ai eu énormément de demandes et de propositions très variées. À Lyon, je donne des cours à des professionnel·les intermittent·es et, ce qui est assez chouette, c’est qu’en tant que femme j’ai plus de stagiaires femmes que mes homologues masculins. Sans même forcer, il y en a pour qui ça compte. Je suis aussi souvent demandée pour des ateliers en non-mixité et aussi pour des accompagnements de projets artistiques.

Parfois je ne peux pas tout accepter, et ça questionne le fait qu’il faudrait peut être former d’autres femmes pour animer ces ateliers et faire en sorte que les collectifs travaillent davantage ensemble. Je suis arrivée dans l’enseignement en me disant que ça me ferait un complément d’activité – le milieu musical étant un milieu précaire. Ça a pris un essor que je n’aurais pas imaginé, et dont je suis fière. C’est très gratifiant et stimulant intellectuellement parce qu’on doit toujours être à jour et se rendre compte qu’on ne sait pas tout. Il faut rester humble.
Ce qui est aussi très agréable c’est la rencontre avec des gens qui sont passionné·es de musique mais qui ne sont pas forcément dans l’industrie musicale. Ça reste frais et sain, en marge des personnes en compétition sur le marché de la musique. Je suis cependant un peu obligée de devoir trouver un juste équilibre parce qu’il me tient à cœur de garder ma casquette d’artiste. Mon rôle d’enseignante a du sens aussi parce que je suis artiste sur le terrain et que mes connaissances du logiciel sont mises a l’épreuve tout le temps via ma pratique artistique. L’un et l’autre peuvent être chronophage et énergivore, mais se complètent très bien.
Il y a donc des choses que je continue sur le long court comme avec les formations à Lyon ou avec le label Nashton qui organise une académie pour accompagner des artistes sur un an. J’y enseigne depuis trois ou quatre ans pour les cours de DJing et Ableton Live. J’essaye d’y aller par palier, de m’écouter et de placer des choses quand je peux le faire correctement.
Aujourd’hui, je suis ravie de constater que la musique électronique n’est plus du tout underground, qu’elle influe et est partout.
Flore
Ton dernier projet s’intitule Legacy & Broken Pieces. Tu indiques à son propos être « fatiguée de la nostalgie que l’on peut trouver dans la musique électronique de nos jours. Avec tout ce qui se passe en ce moment, le monde ne sera plus jamais le même. Alors pourquoi la musique devrait-elle être ainsi ? ». On ressent ici ta volonté de faire avancer le milieu musical et la création à plusieurs niveaux. Comment réponds-tu à cette ritournelle du « c’était mieux avant » assez présente dans le milieu musical ? Vers quoi souhaiterais-tu voir aller la scène de demain en termes d’esthétiques, mais aussi en termes de valeurs ?
Je suis dans le milieu de la musique électronique depuis longtemps. Ce qui m’y fascinait c’était cette fraicheur et le fait de ne jamais avoir entendu cela auparavant. Aussi bien en terme de sonorités qu’en termes de composition : ça ne ressemblait pas du tout à de la musique dite mainstream. Aujourd’hui, je suis ravie de constater que la musique électronique n’est plus du tout underground, qu’elle influe et est partout. J’ai toujours souhaité cela : tu as toujours envie que la musique que tu aimes soit partagée par le plus grand nombre.
Ce que j’ai du mal à comprendre, c’est comment une musique qui se voulait à l’avant-garde et qui maintenant ne l’est plus tant, regarde en arrière, un peu comme une valeur refuge. Certes, en ce moment on a peut être envie de fantasmer les années 1990 et toute la période rave. Mais ça n’est pas la même époque, nous n’avions pas les mêmes outils. Dans ces années, la musique était ce qu’elle était parce qu’il n’y avait pas d’ordinateurs, il y avait des samplers et des synthés.
Aujourd’hui, on a des machines ultra puissantes, des logiciels gratuits, la possibilité de cracker… Donc je comprends encore moins le fait de ne pas vouloir tenter d’autres choses, de bousculer les codes. Je ne dis pas non plus qu’il faut être ultra révolutionnaire, mais simplement d’essayer d’injecter quelque chose qui soit un peu à coté, quelque chose de personnel. C’est surtout ça la question. Je ne fais pas de la musique en réaction à quelque chose.
Quand j’ai composé les morceaux de l’EP, je ne me suis pas dit « tiens, je vais composer pour faire la démonstration de… ». C’est plutôt que ces morceaux étaient là, et quand je les ai vus, je me suis dit que ça pourrait faire un EP. Je me suis demandée comment ces morceaux qui avaient été composés à des moments différents pouvaient rester cohérents ensemble. Et tous avaient cette utilisation de samples assez connus en drum’n’bass ; ils utilisaient certains codes, mais étaient tout de même à côté.
Je ne suis pas quelqu’un d’intéressée par la nostalgie. Ce qui m’intéresse c’est plutôt maintenant.
Flore
Je crois que c’est quelque chose d’assez européen en musique électronique, mais j’ai l’impression que parfois la musique manque d’audace, que j’ai déjà écouté certains morceaux cent cinquante fois (rires). Et ce sont ces gens-là dont on a écouté les morceaux cent cinquante fois qui ont le plus de booking ! Je me demande ce qu’ils vont laisser après, ce qu’ils sèment pour le futur. Forcément, ils doivent avoir leur raison. Mais je ne suis pas quelqu’un d’intéressée par la nostalgie. Ce qui m’intéresse c’est plutôt maintenant.
Parmi tes chevaux de bataille on note l’importance accordée aux questions de représentations, au rééquilibrage d’inégalités de visibilité de certain·es artistes au sein de la scène artistique contemporaine. Sur Instagram notamment tu as lancé la série « Sisterhood Collection », des vidéos « dédiées aux productrices de musiques électroniques ». Pourquoi est-ce important de mener ce combat ?
S’il y a bien une chose auquel le Covid a servi, c’est que pendant cette pause il a permis aux festivals et aux organisateur·ices de se questionner sur beaucoup de sujet. Notamment sur la représentation des femmes. Avant le Covid, j’étais étonnée quand je voyais beaucoup de femmes sur un line up. Aujourd’hui, je suis étonnée quand je n’en vois pas. Il y a vraiment eu un coup d’accélérateur.
Mon combat se situe davantage au niveau de l’esthétique musicale. Historiquement, si tu regardes sur les scènes techno et house, très présentes en France, il y a toujours eu des artistes féminines qui ont réussi à se placer et à tenir les années. Cependant, en ce qui concerne les esthétiques bass music, qui moins connues en France, il y en a peu. J’avais donc envie de mettre en avant des femmes aux esthétiques plus pointues qui peuvent passer en dessous du radar et de leur donner une visibilité.
Une fois que tu changes un peu de méthodologie ou d’outil pour faire de la veille, tu te rends compte qu’en fait des femmes il y en a plein !
Flore
J’entendais le discours des programmateurs – et j’utilise le terme au masculin volontairement – qui me disaient qu’il n’y avait pas beaucoup de femme. J’ai donc eu aussi l’envie de créer un outil, de proposer une sorte de bibliothèque pour contredire l’argument du nombre qui ne tient pas la route ! J’ai voulu que les gens puissent aller y trouver des inspirations quand ils ne savent pas où chercher. Une fois que tu changes un peu de méthodologie ou d’outil pour faire de la veille, tu te rends compte qu’en fait, des femmes, il y en a plein !
C’est juste qu’à chaque fois il y a une sorte de flemmardise d’aller les chercher. On s’est retrouvé longtemps à avoir une dizaine de headliners femmes qui étaient toujours les mêmes : Peggy Gou, The Blessed Madonna, Paula Temple… Ce sont toutes des artistes que je respecte, mais il y avait un certain nombre de programateurs qui se cachaient derrière elles pour dire : « Regardez, on a programmé des femmes ». Mais entre ça et une DJ connue localement, il y beaucoup de femmes au milieu qui pourraient trouver leur place dans ce que je déteste parfois appeler « artistes en développement ». C’est sur ce panel-là que j’aimerais qu’il y en ait plus.
Le point de départ du projet Sisterhood Collection est parti de demandes de mixes pour trois médias : Nova, Juno et Beatport. Je ne voulais pas juste y inclure des nouveautés. Je me suis demandée comment je pourrais faire en sorte de faire trois mixes qui racontent une histoire. J’ai donc voulu n’y mettre que des productions de femmes et ratisser très large en terme de BPM. Un premier mixe irait de 80 à 130, un deuxième de 130 à 150 et le dernier de 150 à 170. J’ai cherché des noms de pleins de manières différentes et j’ai fini par avoir une grande constellation de femmes.
J’ai mis le doigt sur le fait que ma façon de chercher de la musique avait évolué. Sans me rendre compte, dans mes DJ set de club, j’ai beaucoup plus de productions faites par des femmes qu’auparavant. Au-delà de faire un effort, il faut vraiment changer les algorithmes. On critique ceux de Facebook, mais dans la musique, on est bloqué·es par les mêmes. Notamment par la multiplicité des plateformes, le temps, les recherches, le référencement. Il faut être proactif·ve et casser les habitudes pour trouver des choses. C’est un projet qui me tient à cœur, et qui j’espère compte.
Sur les questions de représentation, il y a aussi celles qui concernent les déséquilibres en termes de territoires, de zones géographiques et d’origines des artistes. Récemment nous avons mis en avant sur Le Type dans le cadre de notre série de mixes, une artiste du collectif polonais Oramics : ISNT. Cette plateforme a récemment réalisé une étude démontrant que les principaux médias de musiques électroniques (Resident Advisor, Fact Magazine, Crack…) sur-représentaient les artistes américain·es, anglais·es et plus globalement d’Europe occidentale. Et ce au détriment d’artistes d’Europe de l’Est, de pays du continent africain… Toi-même tu invites l’artiste égyptien 3Phaz à l’IBOAT le 17 décembre. Comment agir à ce niveau pour faire évoluer les choses ? Les artistes et les lieux ont-ils un rôle à jouer ?
Sans trop m’en rendre compte ces derniers temps dans les productions que l’on fait avec Polaar, la question de la représentation se pose beaucoup plus largement. De fait, la moitié des productions que l’on a fait depuis l’existence du label et des soirées doivent être d’artistes qui ne sont pas européen·nes.
Ce qui est sûr, c’est que les médias musicaux depuis le Covid sont en mauvais état. Beaucoup vont vers des contenus qui suscitent de l’intérêt. C’est plus simple de parler de quelqu’un de connu que de parler de certain·es artistes chinois·es perdu·es que j’adore. Les personnes qui sont vraiment passionnées et qui vont sur Resident Advisor, ça ne représente pas une majorité. Ce sont davantage des gens qui aiment sortir, un peu curieux·ses, mais qui ne sont pas forcément pointu·es dans leur sélection musicale qui s’y rendent.

Celles et ceux qui doivent davantage s’impliquer sur ces sujets sont les programmateur·ices, certains festivals et lieux. Sans vouloir faire du chauvinisme, cela fait quelques années que je trouve Nuits sonores à Lyon vraiment pertinent sur ce sujet. Il y a des artistes qui viennent d’un peu partout, je trouve ça vraiment bien. Ensuite est-ce aux musicien·nes de s’emparer de ce sujet ? Je ne sais pas si j’aurais un discours légitime pour parler de ça, même si le sujet est important. Et je pense qu’inconsciemment, programmer un artiste d’Égypte, c’est participer à ce que ça change. L’artiste Abadir est très bon sur ces sujets-là. L’idée, se serait plutôt de tendre le micro aux concerné·es. Ça va être compliqué pour les programmateur·ices, il va falloir aller encore plus loin dans la question des représentations (rires).
Tu vis à Lyon, l’une des villes à laquelle nous nous intéressons chez Le Type à travers notre projet Scene city qui documente les scènes de différentes villes européennes ; peux-tu nous parler un peu de l’état de la scène électronique et musicale lyonnaise ? Comment les acteur·ices se structurent et interagissent ensemble ?
Je ne pourrais en dire que du bien. Je suis souvent amenée à bouger en France et à l’étranger et en comparaison je constate qu’a Lyon il y a un beau vivier. Il y a beaucoup de collectifs, labels, initiatives comme la Dashton Academy ou le collectif féministe Unit Sœur. C’est très diversifié. Historiquement, il s’y est toujours passé beaucoup de choses. Dans les années 1990, c’était sur un terrain plus rock et punk qu’il y avait beaucoup de choses.
Ensuite, il y a eu une première génération en musiques électroniques, plutôt électro, techno et dub. Le label Jarring Effects a vraiment marqué la fin des années 1990 le début des années 2000 sur la scène dub et même d’un point de vue international. C’était donc dynamique et ça a toujours continué. Ces dernières années, je trouve même que ça s’est amplifié, avec encore plus de diversité musicale. J’hallucine de voir à quel point au démarrage de Polaar, dans mon esthétique on était les seul·es, et que maintenant il y a peut être quatre ou cinq label avec qui on joue des morceaux et avec qui on est en contact.
Ce qui est assez sain, c’est que contrairement à ce que l’on pourrait peut croire, plus il y a d’acteur·ices, plus il y a une bonne ambiance. Quand il n’y a pas beaucoup d’acteur·ices, il y a beaucoup de concurrence, de rivalité. Je l’ai vécu fin des années 1990, quand tous les collectifs se tiraient un peu les uns sur les autres. Par contre il y a plus d’acteur·ices que de lieux pour accueillir les événements de ces collectifs. C’est peut être le seul truc qui pourrait manquer à la vile : une salle de trois cents personnes, l’entre-deux entre la Maison M ou le Terminal qui fait 100 places et le club Transbordeur qui en fait 450.
Davantage d’espaces encouragerait les label lyonnais à créer des événements, quand trop encore appréhendent la prise de risque. Forcément, faire venir cinq cents personnes sur des esthétiques de niches, c’est un peu compliqué. C’est un peu le truc qui permettrait à Lyon, ou plus globalement aux villes de France, de créer une véritable scène française. Ça permettrait de s’insérer dans le panorama et de durer, se figer, fédérer un public. Je suis sûre que la structuration va continuer et que les choses se solidifieront.
Pour finir, peux-tu nous parler de tes prochains projets, notamment pour ton label : quelle ambition as-tu pour lui ? Et au-delà, qu’as-tu de prévu pour 2023 ?
Je suis très contente de faire cette soirée à l’IBOAT parce que c’est la première fois que l’on fait une soirée Polaar à Bordeaux. La veille on en fait une en partenariat avec Carhartt au Sucre, à Lyon. Après le Covid, tout le monde s’est tellement rué à programmer des choses quand il y a eu la réouverture des lieux que l’on s’est un peu mis en retrait. Je suis très contente de reprendre.
L’objectif de 2023 c’est de continuer ça, il est question de refaire des soirées à La Station à Paris et d’essayer d’en reprogrammer à Lyon. Sur le plan du label, on attend les vinyles de mon dernier projet qui ont 7 mois de retard (rires). Ça a un peu décalé pas mal de truc parce que j’aime bien être maîtresse du temps. Ça n’est pas possible à faire quand il y a plusieurs sorties qui se télescopent, j’ai l’impression de ne pas faire mon travail correctement. Une fois qu’on aura les copies en janvier, on se focalisera dessus quelques semaines. Entre temps je préparerai la prochaine sortie d’un artiste japonais avec qui on travaille depuis longtemps qui s’appelle Prettybwoy. L’EP sortira en mars.
Je sors aussi un EP sur le label d’un artiste que j’adore qui est basé à Berlin qui s’appelle Peder Mannerfelt. Je me reconnais beaucoup dans sa démarche d’essayer plusieurs esthétiques musicales. Il n’a pas de limite sur ce qu’il produit ni sur les artistes qu’il signe. Je suis très contente de travailler avec lui sur ce projet. J’ai un live audiovisuel avec un artiste qui s’appelle WSK, et l’on jouera à Brest et à Paris.
J’ai une date à Lyon aux Halles Tony Garnier en février. Et enfin l’autre sujet de fierté c’est que je joue à Londres pour l’anniversaire d’un label qui s’appelle Exit Record. C’est le label d’un artiste drum’n’bass assez légendaire qui s’appelle dBridge. Il m’a invité pour les 20 ans et j’en suis très excitée. Je suis honorée d’être invitée par l’une des personnes qui a été un modèle pour moi tant dans sa démarche artistique et que pour son label.