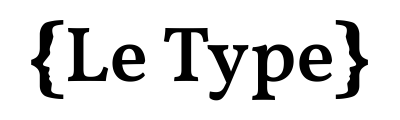Rencontre avec Jeanne Lafitte Boulart, l’une des têtes pensantes du festival basque Udada. Organisé par les activistes culturels du collectif Moï Moï, l’événement s’inscrit dans la continuité du feu Baleapop. Sa prochaine édition aura lieu à Saint-Jean-de-Luz les 17, 18 et 19 juillet prochains.
En basque, uda signifie « été » ; da veut dire « c’est ». Le festival Udada porte donc bien son nom : « c’est l’été », comme nous le raconte Jeanne Lafitte Boulart. Bien connue de la rédaction de Le Type, l’équipe derrière l’initiative n’en est pas à son premier coup d’essai. Elle signe avec Udada un nouvel objet festivalier, forcément singulier, avec un discours et une approche dont on a particulièrement besoin en ces temps politiques et culturels incertains.

Le Type : Salut Jeanne, merci de nous accorder de ton temps. Chez Le Type on connaissait bien Baleapop, un moins Udada, récemmennt apparu dans l’écosystème des festivals de la région. Peux-tu nous le présenter ?
Jeanne Lafitte Boulart : Udada est né au sein du collectif Moï Moï, qui fête ses 20 ans cette année. Après avoir organisé pendant plusieurs années Baleapop, notre premier festival majeur et couronné de succès, nous avons fait une pause de trois ans. Cette période nous a permis de lancer d’autres projets comme notre webradio DIA!.
Avec Udada, nous ne voulions pas simplement « refaire » Baleapop : l’idée était de nous challenger sur le format.
Jeanne Lafitte Boulart
Avec Udada, nous ne voulions pas simplement « refaire » Baleapop : l’idée était de nous challenger sur le format. Udada se situe à mi-chemin entre un festival et une foire d’art. Nous donnons carte blanche à des collectifs et artistes pour imaginer des « pavillons », comme des expositions immersives qui s’animent pendant le festival (rencontres, concerts, tables rondes, etc.).
Udada est à la fois festif et familial. Il se déroule en juillet, période propice à un public plus jeune et ouvert, ce qui nous permet de proposer une programmation riche et variée qui reflète aussi le travail de la radio DIA!.

La société va mal, il faut donc se battre pour maintenir ces espaces de rencontre, ces « bulles » collectives qui rassemblent autour de valeurs communes.
Jeanne Lafitte Boulart
Tu l’as dit ; Udada est le prolongement du festival Baleapop. Comment perçois-tu l’évolution du secteur festivalier entre les débuts de Baleapop et aujourd’hui avec Udada ?
On a vu le pouvoir d’achat baisser. Ça change la donne pour l’accessibilité aux contenus artistiques. Il faut penser à proposer des tarifs abordables pour que tout le monde puisse profiter de la culture et de l’art.
Dans notre cas, on reste sur un format de micro-festival ; on n’a pas forcément suivi la même évolution que les plus gros événements. Mais les fondamentaux restent les mêmes : se concentrer sur le bien-être des festivalier·es, le partage, le vivre-ensemble.
C’est d’autant plus important aujourd’hui : la société va mal, donc il faut se battre pour maintenir ces espaces de rencontre, ces « bulles » collectives qui rassemblent autour de valeurs communes. Pour moi, le festival c’est presque le successeur des tribus : un lieu où l’on recrée du lien et du sens.
Quels sont les défis liés à l’organisation d’un tel événement ?
Le premier, c’est boucler le budget . Il y a de moins en moins d’aides publiques, et les coûts augmentent (technique, matériel, groupes, restauration…). Un autre défi est de proposer une expérience véritablement immersive, d’aller au bout de l’idée des pavillons. C’était déjà une belle réussite l’an dernier. Cette année, on aura trois pavillons et on sent qu’on atteint ce qu’on avait imaginé au départ.
Il faut aussi penser au parcours global des festivalier·es : créer un récit multiple et cohérent. Et puis il y a la dimension locale : on est au Pays basque, un territoire avec une culture, une langue et des valeurs fortes. On veut vraiment faire découvrir ou redécouvrir cette culture, en travaillant avec des groupes locaux, des fournisseurs locaux, et créer cette continuité.


Il y a une vraie dynamique de transmission et de renouvellement au sein de la scène culturelle basque.
Jeanne Lafitte Boulart
Udada est effectivement un festival très ancré dans son territoire ; comment qualifies-tu la scène culturelle du Pays basque qu‘Udada entend célébrer ?
Elle est extrêmement riche et foisonnante depuis plusieurs années : musique, design, art, gastronomie… Il y a des talents incroyables, avec un vrai bagage culturel. En même temps, cette scène sait s’affranchir des codes et imaginer de nouvelles formes d’art très imprégnées de la culture basque et du territoire. Il y a une vraie dynamique de transmission et de renouvellement.
Comment l’équipe organisatrice sélectionne les artistes présenté·es ?
C’est beaucoup basé sur le coup de cœur, les écoutes, les rencontres. Et évidemment le réseau. On veut proposer une programmation ludique, festive et communicative. Avec Udada, on est sur une ligne plus pop et accessible, alors qu’on peut faire du « défrichage » et aller vers des musiques plus pointues sur d’autres événements.

En quoi le festival contribue-t-il aux débats sur l’égalité et la représentation ?
Au sein de l’association, nous avons rédigé un manifeste qui définit des règles de conduite claires et qu’on communique en amont (dossier, site, réseaux). Sur le festival, il y a aussi une signalétique spécifique.
En interne, les femmes occupent des postes clés : il n’y a jamais eu de souci là-dessus. On veille à ne pas tomber non plus dans la discrimination positive forcée en programmant exclusivement des femmes : on veut un vrai équilibre. Par exemple, cette année, le jeudi c’était 50/50, le vendredi 100 % féminin et le samedi 100 % masculin ; ça s’est fait naturellement, sans calcul, mais ça nous va très bien. L’asso s’est construite grâce à l’implication de femmes et d’hommes ensemble.
C’est quoi et c’est qui les publics d’Udada ?
C’est assez familial : des quarantenaires avec enfants, mais aussi un public plus jeune, autour de 25-35 ans qui se déplace pour l’événement.
On s’adapte à ces publics : il y a des ateliers pour enfants, des concerts pensés pour tous les âges. Par rapport à Baleapop, les quadragénaires se sentent très à l’aise ; c’est un beau mélange, avec une ambiance toujours bon enfant, festive et collective.

Comment vois-tu évoluer le festival à court et moyen terme ?
Nous aimerions accueillir encore plus de pavillons, étendre la durée du festival et donner toujours plus de cartes blanches aux collectifs participants. Un peu à la manière d’une mini-foire où l’on vient pour découvrir et s’émerveiller.
Une anecdote marquante d’une édition passée ?
Il y en a plusieurs ! Je pense à la deuxième édition : on avait prévu un pique-nique sur la colline Sainte-Barbe avec vue sur la mer, deux chefs invités, une belle scénographie… Mais la météo a été catastrophique : il a plu sans arrêt. On a fini sous un chapiteau de cirque sur un parking !
Et l’année dernière, on a dû gérer un énorme bug d’internet mondial pendant le festival : trois artistes n’ont pas pu venir… C’était vraiment sport.
En un mot, c’est quoi Udada pour toi ?
Je dirais : communion. C’est le vivre-ensemble, le collectif. Dans la vie comme dans le projet.