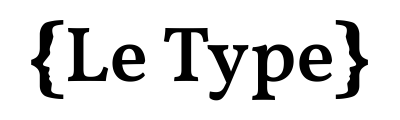Le festival ougandais Nyege Nyege s’est forgé une solide réputation au sein de la communauté électronique globale. Son équipe et une partie de sa communauté artistique seront à Bordeaux pour une édition exceptionnelle les 12 et 13 juillet, entre Les Vivres de l’Art et Bien Public. Pour discuter du festival, de son évolution, de son ancrage en Ouganda et du « combat culturel » qu’il mène, on a rencontré Derek Debru, son co-fondateur : entretien.
Entretien réalisé par Daniela da Fonseca Gomes Nazare et édité par Manola Mariano & Laurent Bigarella
Le Type : Salut Derek, comment vas-tu ? Comment se passe l’organisation de cette édition bordelaise de Nyege Nyege ?
Derek Debru : Ça se passe bien ! Je suis actuellement à Kampala (l’interview a été réalisée à la fin du mois de juin 2025, ndlr) pour préparer l’organisation du festival en Ouganda qui se déroulera du 20 au 23 novembre prochain. Et en parallèle on travaille sur le festival à Bordeaux.
L’été est intense car on fait aussi beaucoup de tournées d’artistes. Et beaucoup de ces artistes tournent pour la première fois, et ont donc besoin de soutien logistique.
Tout le monde est étonné de constater que le festival ait autant grandi. Et ce malgré toutes les difficultés rencontrées, avec le gouvernement ou des groupes religieux. C’est une résilience importante : c’est un des attributs de notre collectif. Nous n’avons jamais abandonné.
Derek Debru (Nyege Nyege)

Le festival Nyege Nyege fête ces dix ans cette année. Quel bilan tires-tu de ces dix années ?
Quand on discute avec les gens de notre collectif ou les gens qui sont venus au festival, on peut dire que c’est devenu une institution. Tout le monde a des anecdotes à partager sur l’événement. On a commencé tout petit, par des soirées. Et puis ces soirées ont grandi, c’est ce qui nous a poussé à tenter d’organiser trois jours de réunion, dans une forêt, au bord d’une île.
Tout le monde est étonné de constater que le festival ait autant grandi. Et ce malgré toutes les difficultés rencontrées, avec le gouvernement ou des groupes religieux. C’est une résilience importante : c’est un des attributs de notre collectif. Nous n’avons jamais abandonné.
On se pose aussi une question sur l’évolution du festival : est ce que grandir c’est forcément mieux ? Cette année, on a décidé de faire une édition qui allait être plus petite. Cela pose beaucoup de questions sur le plan financier, car on reste un collectif avec, entre autre, un studio à gérer, avec beaucoup de frais.
Notre volonté initiale reste d’être un événement populaire. On a toujours fait les choses de manière alternative. Il ne s’agit pas de rentrer dans des cases, ou dans une bulle juste pour cool kids et entre connaisseurs. Il est donc important pour nous de faire un pas vers le grand public. Aux côtés d’artistes qu’il connaît, on peut découvrir des esthétiques moins connues, mais qui peuvent les intéresser ! C’est cet équilibre que nous veillons à respecter : prioriser notre communauté tout en s’ouvrant à un cercle plus large.


Comment le contexte culturel de Kampala a-t-il évolué en parallèle du festival ?
Culturellement, il y aussi le paysage musical de Kampala qui a énormément changé et dont on a fait partie. Le festival essaye d’avoir un rôle précurseur, de mettre des artistes en avant qui sont peu connu·es dans leur scène. Quand on parle de musiques électroniques africaines, il y a énormément de genres et d’artistes qui viennent à l’esprit. Il y a 10 ans, il y avait l’afro house. Aujourd’hui, une grande diversité d’esthétiques cohabitent ici. On a aussi accompagné une génération de jeunes. Certain·es attendent d’avoir 18 ans pour pouvoir se rendre au festival pour la première fois.
Aujourd’hui, on organise environ 400 dates par an à travers le monde.
Derek Debru (Nyege Nyege)
Nyege Nyege, ce n’est pas seulement un festival en Ouganda. Où s’est-il exporté ces dernières années ?
Oui, en fait, le festival s’exporte de plus en plus. On organise une édition à Lagos pour la première fois en octobre. En France, on a déjà fait deux éditions à Aubervilliers, au Point Fort, et on va donc bientôt s’installer à Bordeaux. On collabore aussi avec un club à Amsterdam, avec qui on organise un événement de deux jours sur trois scènes, réunissant une grande partie des artistes du collectif en tournée.
En parallèle, on organise de nombreuses soirées Nyege Nyege dans le monde entier : récemment en Australie, mais aussi un peu partout en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Ces événements nous permettent de mettre en avant des artistes qui, autrement, n’auraient peut-être pas eu l’opportunité de tourner ou d’être bookés.

On essaie de créer une ambiance reconnaissable : les publics savent qu’ils vont découvrir de nouveaux artistes, aux côtés de quelques noms plus familiers. C’est une manière d’ouvrir la scène à des talents émergents, de leur offrir une première expérience à l’international, et de connecter différents publics.
Aujourd’hui, on organise environ 400 dates par an à travers le monde. Certaines sont des showcases Nyege Nyege, d’autres sont portées par des artistes du label qui tournent sous leur propre nom, tout en représentant l’esprit du collectif.
Ce qu’on espère toujours, c’est retrouver cette diversité de publics : des mélomanes, des amateur·ices de danse, des personnes afro-descendantes heureuses de voir de la musique alternative du continent, des gens de tous âges et horizons. Ce mélange, c’est le cœur de Nyege Nyege
Derek Debru (Nyege Nyege)
Pourquoi avoir choisi Bordeaux pour accueillir la prochaine édition française de Nyege Nyege ?
C’est venu un peu par hasard, à travers des rencontres. À l’origine, c’est l’équipe de Pan African Music qui nous a beaucoup soutenus, en promouvant le festival et nos artistes. C’est grâce à eux qu’on a pu organiser les premières éditions à Aubervilliers. Mais cette année, avec les Jeux Olympiques, ce n’était plus possible.

De fil en aiguille, on a été mis en contact avec l’équipe de Feu Flamme et du collectif La Sueur, qui nous connaissaient déjà un peu. Ils nous ont proposé de venir à Bordeaux. On y avait déjà fait un takeover pour la clôture du festival Climax, qui s’était très bien passé. L’accueil local a été très enthousiaste, donc on s’est dit que c’était une belle opportunité.
C’est aussi intéressant pour nous d’explorer d’autres territoires que Paris, où on fait déjà beaucoup de choses. Bordeaux permet de toucher un nouveau public, de tisser des liens avec d’autres scènes locales. Le programme s’annonce riche : on a ajouté une nuit dans un club (Bien Public, ndlr) qui ouvre spécialement pour l’occasion. On aura un vrai format « festival » avec des lives, des sets, de la danse non-stop.
Ce qu’on espère toujours, c’est retrouver cette diversité de publics : des mélomanes, des amateur·ices de danse, des personnes afro-descendantes heureuses de voir de la musique alternative du continent, des gens de tous âges et horizons. Ce mélange, c’est le cœur de Nyege Nyege. Des espaces où les gens se rencontrent, échangent, découvrent, vibrent ensemble. On espère retrouver cette magie à Bordeaux, comme à Paris ou Amsterdam.

Comment se construit la programmation de chaque édition de Nyege Nyege ?
La première étape pour une édition comme celle de Bordeaux, c’est de rassembler les artistes du collectif qui sont en tournée. Ces éditions européennes sont des moments où toute la famille Nyege Nyege peut se retrouver. Les cachets sont modestes, mais l’esprit du festival, c’est d’être ensemble, de créer une énergie collective. On inclut aussi des artistes affilié·es, basé·es en Europe, comme MOESHA 13 (Marseille), ou Violence Gratuite (Paris).
On tient aussi à inclure la scène locale à chaque édition. À Bordeaux, on collabore avec le collectif La Sueur, qui nous a conseillé des artistes de la région. C’est comme ça qu’on a découvert DJ Koyla, qu’on est ravi d’inviter. Ce lien avec le territoire est essentiel, on ne veut surtout pas débarquer « en bloc », sans écoute.
On repère aussi des talents via nos réseaux ou des suggestions d’ami·es. Par exemple, un artiste comme Boutross Munene, énorme au Kenya, viendra pour la première fois. Même s’il reste inconnu du public français, c’est l’occasion de faire des découvertes fortes. À côté de cela, on invite aussi des noms plus familiers, comme Tatyana Jane, pour créer des points d’accroche.
L’édition bordelaise se déroule sur deux jours, deux scènes, avec une limite horaire à minuit. On essaie donc de maximiser l’impact avec un nombre réduit d’artistes. On ajoute une nuit en club pour prolonger l’expérience et ouvrir plus de créneaux. Mais parfois, certains projets qu’on aime doivent être écartés pour des raisons de budget ou de timing. C’est frustrant, mais c’est le jeu. L’idée, c’est aussi de tester : si le public joue le jeu et arrive tôt, on pourra dans le futur programmer des artistes dès l’ouverture, comme on le fait en Ouganda.
Comment gères-tu l’organisation du festival depuis Kampala, avec toutes ces dates à l’international ?
C’est vrai que ce n’est pas simple, mais on a une petite équipe solide. La partie booking et tournées est gérée entre Kampala et Bruxelles, par Lola, Pauline, et Pö (qui est aussi une de nos artistes). Moi, j’interviens en appui, plutôt sur la programmation, la direction artistique, ou en accompagnement ponctuel.
Quand un·e artiste part en tournée pour la première fois, j’essaie d’être là. C’est un moment clé, autant pour l’aider que pour lui donner un retour sur ses dates. Sinon, entre le label, les résidences à Kampala, et les tournées, on se partage les rôles du mieux qu’on peut.
Un point important pour nous, c’est que les artistes deviennent rapidement autonomes. On leur donne les outils — billets, contacts, éléments de communication — et ils et elles apprennent à gérer. C’est essentiel pour qu’ils puissent voler de leurs propres ailes, surtout quand on tourne dans autant de pays.
Ce qui me frappe, c’est de voir qu’on peut avoir 17 sous-genres pour le rock sur Spotify, mais rien pour le singeli, le gqom, le balani, ou le coupé-décalé.
Derek Debru (Nyege Nyege)


Comment perçois-tu l’évolution des scènes afro-électroniques et l’enjeu de leur reconnaissance, au-delà des étiquettes réductrices comme « musiques du monde » ou « afro-musique » ?
C’est un combat permanent. Un combat pour exister, pour être représenté de manière juste, pour que nos musiques soient reconnues dans leur richesse et leur complexité – pas juste sous l’étiquette fourre-tout « afro » ou « world ». Ce qui me frappe, c’est de voir qu’on peut avoir 17 sous-genres pour le rock sur Spotify, mais rien pour le singeli, le gqom, le balani, ou le coupé-décalé, qui sont pourtant suivis, vivants, dansants. Donc, quand on sort nos sons, on est souvent obligés de choisir des catégories comme « leftfield electronic », « bass music » ou carrément « world music », ce qui n’a aucun sens.
Ce qu’il faut défendre, c’est la diversité réelle des scènes afro-électroniques et aussi le droit de nos artistes à ne pas être enfermé·es dans leur origine. Un mec comme Authentically Plastic, ou Slikback, ou Nsasi – leur son ne crie pas « Afrique ». Ils font de la musique électronique, point. Et pourtant, on les classe toujours sous l’étiquette « african electronic » ou pire, on cherche une exotisation, comme si c’était une exception.
On n’a pas besoin qu’on dise « metal africain » à quelqu’un qui fait juste du bon vieux metal. Il veut juste être dans la catégorie metal, comme tout le monde. C’est une question de regard : comment les médias, les programmateur·ices, le public nous perçoivent. Et souvent, on reste dans une logique centre / périphérie, où l’Europe, par exemple, reste le centre culturel qui crée les cases, et nous, on est obligé·es d’y entrer si on veut exister dans ce marché.
Mais il faut refuser ça. Refuser d’être assigné à résidence culturelle. C’est aussi pour ça qu’on voit des artistes hybrides qui déroutent les programmateurs. Une artiste comme DJ Pö, par exemple, peut faire un live super expérimental, très vocal, très modulaire… et dans un autre set, envoyer du banger tropical pour le dancefloor. Et là, les gens ne savent plus comment l’identifier. C’est leur problème, pas le nôtre.
Heureusement, les lignes bougent. Des festivals comme Dekmantel en Europe, où on ne voyait que de la techno lisse il y a dix ans, programment aujourd’hui des artistes comme DJ Diaki, Travella, Anti Varius. Les choses changent. Des programmateur·ices, des médias, prennent ce risque, et ça paie. Les publics, eux aussi, veulent être surpris. Il y a une lassitude de la techno clonée ou des sets trap calibrés. Même le public le sent.
C’est un combat culturel, global, contre l’homogénéisation. Il faut défendre les marges, les bizarreries, l’hybridité.
Derek Debru (Nyege Nyege)
Mais paradoxalement, les jeunes sont parfois plus fermés que les trentenaires. Ils veulent ce qu’ils connaissent déjà. Il faut les pousser à sortir de l’algorithme, à aller en soirée sans connaître tous les noms, à soutenir des scènes locales, à s’aventurer ailleurs. C’est un combat culturel, global, contre l’homogénéisation. Il faut défendre les marges, les bizarreries, l’hybridité. C’est pour ça qu’on est là. On fait partie de ce combat-là.

Le festival Nyege Nyege a évolué aussi dans un contexte politico-culturel ougandais assez tendu, peux-tu nous en parler ?
Ça a commencé en 2018. Cette année-là, tout a explosé. Le ministre de l’Éthique, le père Lokodo, est arrivé sur le site du festival , en personne, le mercredi, et a déclaré : « Ça fait trois ans que je vous cherche. »
Il a immédiatement lancé un discours moraliste très violent, accusant le festival de promouvoir l’homosexualité, la zoophilie, des pratiques sataniques, et j’en passe. Il a dit qu’on pervertissait la jeunesse, qu’on détruisait la morale du pays. Le lendemain, il tenait une conférence de presse au Parlement. Et là, ça a pris feu dans tous les sens, au niveau local comme international : BBC, CNN… tout le monde en parlait.
On a dû expliquer ce qu’était Nyege Nyege. Déjà, le nom lui-même, il dérange : en kiswahili, au Kenya et en Tanzanie, il a une connotation sexuelle, ça peut vouloir dire « envie irrépressible » ou « excitation ». En ougandais, c’est aussi le nom d’un instrument à clochettes, une danse, une impulsion rythmique. Pour nous, ça veut dire avant tout l’envie irrésistible de danser. Mais on sentait que ce nom, plus le fait d’organiser un festival en pleine nature – ce qui n’est pas courant ici – faisait déjà peur à certains.
Cette année-là, on avait un sponsor massif, MTN, un gros opérateur télécom, donc il y avait de la pub partout : abribus, TV, SMS, radios… Ce niveau de visibilité a aussi déclenché une vague de réactions, certains allant jusqu’à dire que le ministre voulait juste extorquer de l’argent pour faire taire la polémique. Finalement, on a pu maintenir le festival, mais sous conditions : disclaimer public, 200 policiers en civil, présent·es uniquement pour s’assurer qu’il n’y ait « pas de garçons qui s’embrassent », pas d’homosexualité. C’était un climat très pesant.
On crée des espaces. On rend visibles des gens, des sons, des expressions. On ouvre le débat.
Derek Debru (Nyege Nyege)
Et le plus dur, c’est que pour la communauté queer de Kampala, Nyege Nyege avait été pendant plusieurs années un espace rare de liberté. On ne parle pas de militantisme ou de provoc’, mais juste de respirer, exister, danser sans crainte. Cette surveillance, cette pression, c’est venu briser un peu cette bulle de liberté.
Depuis, chaque année, il y a des groupes religieux extrémistes qui s’en prennent au festival : des pasteurs qui brûlent nos affiches publiquement, des leaders musulmans qui proclament que Nyege Nyege est haram. C’est toujours les mêmes discours conservateurs contre la différence, la danse, le corps, la musique, voire même contre les traditions locales. Certain·es vont jusqu’à dire que jouer du tambour ou danser la danse traditionnelle, c’est le mal.
Mais malgré tout ça, on a décidé de s’engager davantage politiquement, sans devenir militants au sens strict. On crée des espaces. On rend visibles des gens, des sons, des expressions. Et on ouvre le débat. Et aujourd’hui, Nyege Nyege, c’est devenu un sujet national. Quand un religieux dit : « Je suis contre Nyege Nyege », il y a de plus en plus de gens qui se demandent : « Attends, ce type est aussi contre la danse ? Contre qu’on s’amuse ? Contre la musique ? ». Et c’est là que les discours ultra-moralisateurs se fissurent. Parce qu’ils ne s’attaquent plus juste aux minorités, mais à la joie collective. Et quelque part, ça nous conforte dans l’idée que ce qu’on fait est politique, même sans slogan. C’est un acte de résistance douce, par la culture, par le son.