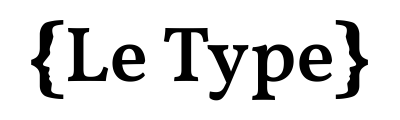Rencontre avec la compagnie Le Bruit du Silence, à l’occasion de la cinquième édition du festival bordelais IMAGO. L’événement, « où le handicap se saisit de la création contemporaine », incluait cette année dans sa programmation la dernière pièce de théâtre de cette compagnie, Papillons. Retour avec Isabelle Florido sur le processus de création de la pièce et sur la place que prend la langue des signes françaises dans leur spectacle.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.
Crédit photo : Morgane Defaix
Le Type : Papillons est un spectacle « hopepunk » ; pourriez-vous définir ce dont il s’agit ?
Isabelle Florido (Cie Le Bruit du Silence) : Le hope punk est un courant artistique qui choisit l’espoir actif plutôt que la résignation, et qui imagine des futurs réalistes mais positifs. À rebours du cynisme ambiant, le spectacle affirme que l’engagement, la créativité et la solidarité peuvent transformer le monde, pas demain, mais dès aujourd’hui.
Comment a été pensée l’intégration de la langue des signes françaises (LSF) dans le spectacle ?
La compagnie Le Bruit du Silence propose des spectacles bilingues français et LSF depuis sa création en 2003. Je suis moi-même « CODA » (Child of Deaf Adults), la langue des signes est donc ma langue maternelle. Notre démarche est à la fois artistique et politique : explorer l’extraordinaire potentiel théâtral de cette langue et créer un pont entre le monde des sourd·es et le monde des entendant·es.
Nous ne voulions pas que la langue des signes soit un simple outil d’accessibilité mais qu’elle soit naturellement présente au plateau et nécessaire dramaturgiquement.
Isabelle Florido (Cie Le Bruit du Silence)
Quels sont les défis liés à l’utilisation de la LSF dans le cadre d’une telle pièce ?
Nous sommes trois comédiennes au plateau : Thumette Léon, qui est sourde, Agnès Pelé et moi-même. Agnès et Estelle Coquin, la metteuse en scène, ne savent pas signer. La présence d’interprètes sur tout le processus de création a été nécessaire pour que le dialogue soit fluide au sein de l’équipe et que tous les enjeux, qu’ils soient liés aux futurs souhaitables ou à la langue des signes, soient compris par toutes.
Nous avons également travaillé avec une dramaturge LSF, Marie Lamothe, qui veille à ce que les publics sourds et entendants reçoivent le même spectacle. Le principal défi a cependant résidé dans l’écriture du spectacle : nous ne voulions pas que la langue des signes soit un simple outil d’accessibilité mais qu’elle soit naturellement présente au plateau et nécessaire dramaturgiquement.

Vous évoquez que dans Papillons, la LSF devient la « langue de la révolution, une langue du lien, du vivant et de la transformation. » Pouvez-vous revenir sur cette vision ?
L’auteur de Papillons, Gabriel de Richaud (membre de l’Institut des Futurs Souhaitables) a inventé une Histoire du Futur. En 2068, date où commence le spectacle, nombre de victoires écologiques et féministes auront été remportées, et la langue des signes française aura été inscrite dans la Constitution depuis deux décennies.
C’est grâce à Luma, jeune militante sourde, que la langue des signes se diffuse chez les résistant·es dès 2024 puis devient la langue de la révolution. Dans notre futur naissent aussi les Poèmes Cimains, ces poèmes visionnaires que l’on ne peut dire qu’à six mains…
Vous invitez les spectateur·ices à apprendre un « chansigne » et à participer aux spectacles. En quoi cette dimension participative était importante pour vous ?
La plupart des précédents spectacles de la compagnie se terminent par un moment interactif qui réjouit toujours le public. Pour Papillons, qui invite chacun à prendre en main son avenir, à se mettre en mouvement, cette dimension participative du spectacle devenait nécessaire.
En même temps que cet appel à chansigner avec nous – qui n’est pas réservé aux seul·es sourd·es -, nous avons proposé à des chorales de s’approprier le chant à deux voix. Ce devrait être très joyeux et émouvant de voir l’ensemble du public, entrainé par les choristes et chansigneurs volontaires, chanter et chansigner ensemble ce chant d’espoir, avant de venir danser et refaire le monde avec nous.
Votre spectacle est centré autour de la LSF mais aussi de la musique. Comment ces deux langages communiquent pendant la pièce, et en quoi racontent-ils chacun leurs propres histoires ?
Thumette a grandi dans une famille de musicien·nes et a développé une relation privilégiée avec la musique. Depuis plusieurs années, elle développe le chorésigne, un langage chorégraphique qui inclut des signes de la LSF. Un tableau de Papillons sera chorésigné.
Par ailleurs Thumette pratique la danse soufie et nous avons créé une séquence chant/violon/danse soufie qui, en plus d’être extrêmement poétique, sera un hommage à Rana Gorgani, danseuse iranienne, qui pratique la danse soufie alors que c’est interdit aux femmes en Iran.
Les restrictions budgétaires croissantes ne permettent pas toujours aux théâtres de mettre en place l’accessibilité ou la programmation qu’ils souhaiteraient.
Isabelle Florido (Cie Le Bruit du Silence)
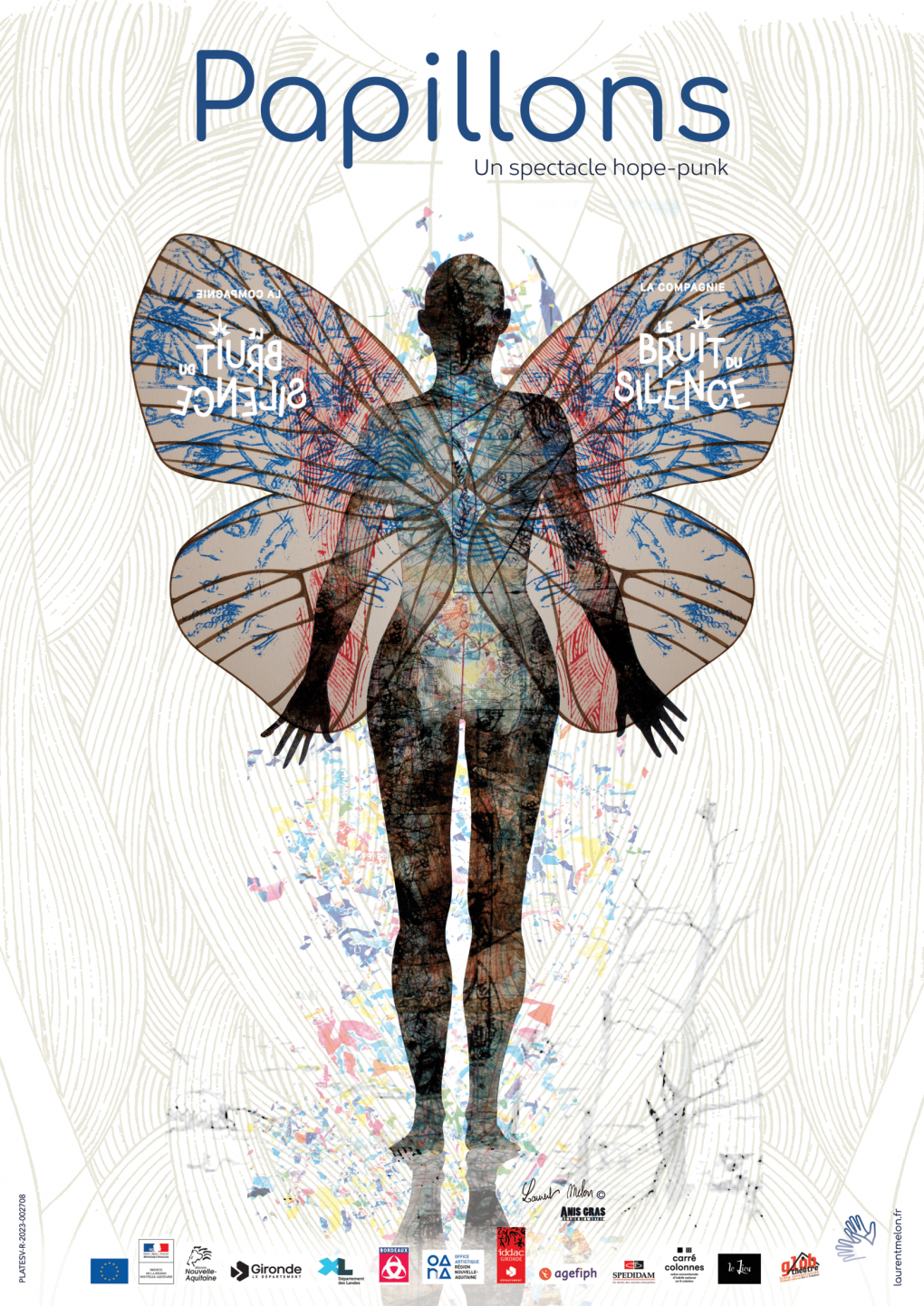
À Bordeaux, la pièce sera jouée dans le cadre du festival IMAGO, « Cultivons nos singularités », dédié à la thématique du handicap. Le monde du théâtre s’intéresse-t-il suffisamment à cette question selon vous ?
Les actions de sensibilisation à l’invisibilisation des artistes sourd·es et à la nécessité de proposer au public sourd des spectacles adaptés portent doucement leurs fruits, et de plus en plus de lieux cherchent ponctuellement des spectacles en langue des signes. Malheureusement, les restrictions budgétaires croissantes ne permettent pas toujours aux théâtres de mettre en place l’accessibilité ou la programmation qu’ils souhaiteraient.
Avez-vous en tête d’autres initiatives vertueuses dans le milieu culturel qui vise à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap (qu’on parle des artistes ou des publics) ?
L’Île de France a également son festival IMAGO, auquel nous aimerions être intégré·es la saison prochaine. Le festival Souroupa, à Nice, a longtemps permis de mêler artistes sourd·es et entendant·es. Malheureusement sa directrice Marie-José Chabbey n’a encore trouvé personne pour prendre sa succession (à bon entendeur…).
Je ne peux ici lister tous les festivals, lieux, compagnies qui favorisent cette inclusion. Quoi qu’il en soit, merci de leur donner de la visibilité dès que possible et merci de votre coup de projecteur sur la compagnie Le Bruit du Silence et sur Papillons !
- Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.