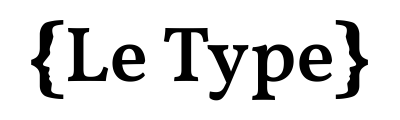On a rencontré la compositrice, écrivaine et chorégraphe Samar Haddad King qui présentera Gathering lors de la dixième édition du FAB à Bordeaux du 8 au 11 octobre prochain. Une pièce participative riche en portée significative pour son autrice palestinienne qui entend célébrer la culture de son pays. Son processus d’écriture, sa vision de l’art comme outil de sensibilisation dans le contexte du génocide en cours à Gaza, les restrictions sur les libertés artistiques subies par celles et ceux qui prennent la parole sur ce sujet : entretien.
Crédit photo de couverture : Jeenah Moon (pour The New York Times)
Le Type : Comment a commencé l’écriture de Gathering ?
Samar Haddad King : Cela a commencé pour plusieurs raisons. Je pense souvent que le travail artistique naît d’impulsions et de petites curiosités qui finissent par se croiser. Pour moi, l’une de ces curiosités était la guerre, en particulier la manière dont elle a changé au XXe siècle avec l’apparition de nouvelles armes. Toute la structure de la guerre s’est transformée. C’était mon point de départ : comprendre comment les guerres évoluent en cycles, et comment chaque bascule modifie l’ensemble du paysage.
En même temps, je relisais Guerre et Paix – que j’avais lu pour la première fois au lycée – et je réfléchissais à la façon dont ces grands récits de guerre et de paix s’entrelacent avec l’histoire. C’était un premier fil.

Une autre impulsion est venue après la création d’une œuvre précédente, Losing It. Pour mon prochain travail d’ensemble, je voulais créer quelque chose qui puisse toucher ma communauté en Palestine, une pièce qui brise le quatrième mur de la scène à l’italienne traditionnelle. Dans notre culture, lorsqu’on invite quelqu’un chez soi, il est véritablement le bienvenu.
Où que j’aie vécu, en Palestine, en Alabama, à New York, cela a toujours été central : quand on entre quelque part, on est nourri, on est libre de prendre ce que l’on veut. Je dis souvent aux gens qui viennent chez moi : « Ne demandez pas si vous pouvez prendre quelque chose si vous la voyez : prenez-la. » Je voulais que le public ressente ce même sentiment d’accueil dans un espace.
Je voulais créer une pièce simple, directe, capable de voyager partout.
Samar Haddad King
Ainsi, cette impulsion et ma curiosité ont commencé à se combiner : mes recherches sur la guerre, mon intérêt pour les cycles, mon désir culturel d’accueillir et d’héberger. Et parallèlement, je réfléchissais à la question de l’accessibilité. L’art contemporain s’est énormément développé en Palestine et dans le monde arabe au cours des 30 dernières années. Mais beaucoup de publics estiment encore que l’art contemporain est difficile à comprendre – alors que les formes classiques sont enseignées à l’école, familières, plus faciles à appréhender. Montrez la Joconde, on la reconnaît. Montrez un Rothko, et la plupart disent : « Je ne comprends pas. » Ajoutez à cela notre capacité d’attention de plus en plus fragmentée, et il est plus difficile que jamais de se concentrer sur l’art. Je le constate même dans ma propre famille.

Je voulais donc créer une pièce simple, directe, capable de voyager partout. C’était l’impulsion initiale en 2018. Gathering a par la suite été créée en 2024. L’histoire d’Israa n’a commencé à se dessiner qu’au début de 2023, même si j’avais déjà écrit son récit dès 2018. Beaucoup pensent que l’œuvre a été conçue en réaction aux horreurs récentes à Gaza, bien que l’occupation dure depuis plus de soixante-dix ans. L’histoire n’est pas nouvelle.
Pour moi, chaque pièce est un univers. Quand je travaille avec des artistes, je leur dis : nous construisons un monde avec ses propres règles, sa propre logique. Nous lui donnons vie, couleur, structure, pour que, lorsque nous en brisons les règles, nous sachions pourquoi.
Lorsque vous écriviez Gathering, comment imaginiez-vous sa dimension interactive, et comment pensiez-vous qu’elle se transformerait sur scène ?
Quand on construit un univers, on construit aussi ses règles. Je devais donc me demander dès le départ : pourquoi le rendre interactif ? Avec toute la technologie dont nous disposons aujourd’hui, j’aurais pu utiliser beaucoup de choses : de la vidéo en direct, de la musique diffusée depuis la Palestine, des caméras sur scène. Mais avec l’interaction du public, je devais être attentive. Elle a été utilisée partout dans le monde de l’art, parfois de façon passionnante, parfois moins.
Dans Gathering, le rôle du public est d’amplifier ce qui se passe sur scène : déplacer des objets, produire des sons, donner de la force à la performance.
Samar Haddad King

Au début, j’avais imaginé créer une application où le public voterait pour faire des choix. Mais j’ai vite compris que ce qui comptait vraiment, c’était la quantité et les nombres : la présence des gens, leur énergie. Pensez à un mariage. Au Levant (بلاد الشام, Bilad al-Sham), quand on danse la dabké (danse de groupe en Palestine qui s’accompagne d’instruments à vent traditionnels et de chants populaires, ndlr), ce n’est pas seulement amusant à cause des pas. C’est parce que 200 personnes la dansent ensemble. Cette énergie collective porte les interprètes. Dans Gathering, le rôle du public est d’amplifier ce qui se passe sur scène : déplacer des objets, produire des sons, donner de la force à la performance.
Nous avons établi des règles très claires. Ce n’est pas le chaos. Il s’agit de protéger à la fois les interprètes et le public. La participation est optionnelle, et elle peut prendre de nombreuses formes : déplacer quelque chose dans l’espace, rejoindre un son collectif, ou simplement choisir d’observer. Car observer est déjà un acte de participation. Nous avons donné quatre représentations à New York, et chacune était différente. Parfois, les places participatives étaient prises immédiatement, certains cherchaient même un moyen de rejoindre l’action. D’autres fois, le public était plus prudent au départ. Mais aucun public n’a jamais refusé de participer. Cette curiosité, ce désir d’entrer dans l’œuvre, a toujours été présent. Au fond, la pièce est une grande invitation : entrer dans un autre monde, celui d’Israa.
Quelles ont été les difficultés de se concentrer sur l’histoire d’un individu alors que la réalité plus large en Palestine est si éprouvante ?
C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi. Avec tant de morts, de deuil, de famine et de violence, certains demandent : comment peut-on justifier de se concentrer sur l’histoire d’une seule personne ? Pour moi, c’est la seule manière d’atteindre la joie et la résilience. Les informations sont pleines de chiffres, mais les chiffres effacent l’humanité. Une histoire, comme celle d’Israa, la ramène.
On peut se souvenir de l’histoire de Hind Rajab, cette fillette de cinq ans piégée dans une voiture encerclée par l’armée israélienne, dont l’ultime appel téléphonique a été enregistré avant qu’elle ne soit assassinée. Cette seule histoire porte le poids de milliers d’autres. Et quand un réalisateur tunisien a présenté récemment à Venise un film consacré aux derniers instants atroces de Hind – recevant une ovation debout de 23 minutes – cela m’a rappelé combien l’art peut encore créer un espace pour le deuil, la mémoire et la survie. Il ne s’agit pas des 23 minutes d’applaudissements, mais de l’action que ce témoignage peut susciter pour empêcher que d’autres meurtres ne se produisent.
Le désespoir est aujourd’hui accablant. Les massacres continuent, les colonies s’étendent. Pourtant, je crois que parfois les choses empirent avant de s’améliorer. Mon travail, c’est de continuer à avancer, de maintenir le feu allumé. Mon rôle est de raconter des histoires, d’emmener le public dans un voyage, qu’il soit spectateur·ice, participant·e, ou les deux. D’ouvrir une porte pour qu’il voie quelque chose de nouveau, ou de tendre un miroir pour qu’il découvre quelque chose en lui. C’est cela, Gathering : porter ensemble le deuil, mais aussi la résilience, dans un seul et même monde.
Nous, Palestinien·nes, sommes résilient·es et plein·es de joie, même en vivant sous un système oppressif. Malgré tout ce qui nous arrive, nous gardons notre joie.
Samar Haddad King

Dans le dossier de presse du FAB Festival, vous dîtes dans une interview que la résilience définit non seulement la pièce elle-même mais aussi l’esprit palestinien. Comment vouliez-vous la faire résonner dans Gathering ?
Nous, Palestinien·nes, sommes résilient·es et plein·es de joie, même en vivant sous un système oppressif. Malgré tout ce qui nous arrive, nous gardons notre joie. Chaque fois que nous accueillons des visiteur·ices, nous créons encore de la chaleur, de l’hospitalité, de la célébration. Pourtant, l’occupation dure depuis plus de 70 ans. La Nakba en 1948 a déplacé plus de 800 000 personnes de leurs maisons et de leur pays, et de nouvelles vagues de massacres, de démolitions et d’expulsions continuent aujourd’hui. Quand on n’a pas de contrôle véritable sur sa propre maison, sur son propre avenir, il faut trouver un autre moyen de survivre. C’est pourquoi la résilience et la joie sont si profondément ancrées en nous. Nous refusons d’abandonner, pas avant d’être libres.
Gathering est presque un hommage à cet esprit palestinien : à ma maison, à mon peuple, à ma culture. Une culture chaleureuse, généreuse, drôle, festive.
Samar Haddad King
Cette résilience est aussi enracinée dans la communauté. J’étais récemment à Marseille avec une Palestinienne qui avait quitté Gaza plus tôt cette année ; sa famille, comme tant d’autres, avait été déplacée d’innombrables fois. Elle était choquée de voir des personnes vivre sans abri dans les rues en France. En Palestine, nous n’avons pas le concept de sans-abrisme. Oui, aujourd’hui les maisons sont détruites, 80 % des infrastructures ont disparu. Mais en Palestine, personne n’est laissé sans lit, parce que la famille et la communauté vous absorbent et vous soutiennent. Ce sentiment de soin, d’appartenance, est immense dans notre culture.
Pour moi, Gathering est presque un hommage à cet esprit : à ma maison, à mon peuple, à ma culture. Une culture chaleureuse, généreuse, drôle, festive. Et même lorsque nous voyons les mêmes images que nos parents et grands-parents ont endurées, comme perdre tout en une seconde, y compris celles et ceux que nous aimons, nous trouvons encore des moyens d’avancer. C’est cela, pour moi, la force ultime.
Des responsables politiques ont tenté de nous réduire à un statut de sous-humains, en laissant entendre que nos vies comptaient moins. L’art conteste cela. Il rappelle que nos vies, elles comptent.
Samar Haddad King

Alors même que nous assistons à un génocide en cours à Gaza, les sociétés, notamment occidentales semblent assez peu prendre la mesure de cette tragédie. Voyez-vous l’art et la culture, et des œuvres comme la vôtre, comme des outils de sensibilisation ?
Absolument, l’art peut éveiller les consciences. J’ai rencontré des personnes qui n’avaient jamais rencontré un·ne Palestinien·ne ou même un·e Arabe et, parfois, leur image de nous était négative ou déformée. Le fait de nous rencontrer en personne, de découvrir nos récits, devient toujours un moyen de trouver un terrain d’entente et de reconnaître notre humanité. Des responsables politiques ont tenté de nous réduire à un statut de sous-humains, en laissant entendre que nos vies comptaient moins. L’art conteste cela. Il rappelle que nos vies, elles comptent.
Avant que le génocide actuel ne commence, je disais souvent : toutes les ressources dépensées pour nous détruire pourraient à la place servir à construire des écoles (améliorer les systèmes de santé, la qualité de l’air, la liste est sans fin) dans les pays qui financent les guerres actuelles. L’art devient alors un lieu de rencontre, un lieu d’ancrage. Le théâtre, en particulier, peut être un espace très démocratique et ouvert. Même s’il n’attire pas toujours de nouveaux publics, les théâtres avec lesquels nous travaillons font de réels efforts pour accueillir des populations diverses : des personnes malvoyantes ou malentendantes, des nouveaux arrivant·es issu·es des communautés arabophones, des enfants, des familles, ainsi que des personnes issues de milieux socio-économiques plus fragiles. Les questions de transport, d’accessibilité et de programmation intergénérationnelle font toutes partie de ce travail pour rendre le théâtre accueillant.
Avec Gathering, des enfants de six ou sept ans peuvent assister au spectacle, et des ateliers sont pensés pour tous les âges. C’est encore tôt, mais nous essayons d’ouvrir des portes pour chacun. L’art est une petite fissure dans un monde immense, souvent indifférent. Mais c’est une fissure que nous pouvons maîtriser. Et si elle suscite de l’empathie, de la connexion ou de la conscience, alors elle a du sens. Nous avons eu la chance de collaborer avec des théâtres en France qui veulent que ce changement advienne, portés par des responsables extraordinaires.

En Europe et ailleurs dans le monde, la pression s’accentue sur les artistes pour éviter de parler de Gaza et du génocide en cours. Comment vivez-vous aujourd’hui la censure qui menace les artistes dans leur liberté artistique ?
La censure est bien vivante. Mais pour nous, Palestinien·nes et beaucoup d’Arabes, elle a toujours existé. Aujourd’hui, même des Européen·nes occidentaux, blancs, qui prennent la parole, subissent des attaques. Pour elles et eux, c’est nouveau. Pour nous, c’est familier. La censure prend de nombreuses formes. Même utiliser le mot « Palestinien » peut être controversé, selon le contexte.
Celles et ceux qui organisent ces attaques cherchent à réduire tout le monde au silence.
Samar Haddad King
Aujourd’hui, la censure est révoltante. Elle est sélective : le même mot, dans le même pays, peut provoquer deux réactions totalement différentes. Celles et ceux qui organisent ces attaques cherchent à réduire tout le monde au silence. Ce n’est pas une théorie du complot : il existe des listes, et beaucoup d’entre nous y figurent. Je refuse de me taire, et beaucoup de mes pairs aussi, même si nous devons composer avec des questions de sécurité. Il ne s’agit pas d’être « cancel » – ce qui concerne souvent des théâtres nationaux ou des financements – mais bien de survie. Pour les réfugié·es ou les demandeur·euses d’asile, la censure peut signifier perdre son foyer ou être séparé de sa famille.
Si vous êtes privilégié·e, si vous avez une citoyenneté qu’on ne peut pas vous retirer, et que votre principal risque est de perdre des opportunités ou des financements, alors prenez position.
Samar Haddad King
Je dis toujours : si vous êtes privilégié·e, si vous avez une citoyenneté qu’on ne peut pas vous retirer, et que votre principal risque est de perdre des opportunités ou des financements, alors prenez position. Plus il y a de voix qui s’élèvent, plus il devient difficile de censurer. Pour certains d’entre nous, cependant, parler n’est pas un choix, mais une question de morale.
L’art est censé combattre le mal au nom du bien, et pourtant nous devons encore lutter. Même deux ans plus tard, on débat pour savoir s’il faut appeler ce qui se passe « génocide ». Il y a du cynisme. Au début, on sent un léger basculement de la conscience publique, mais rien ne change. La situation reste atroce, cauchemardesque. Parfois, continuer à créer en étant témoin de ces horreurs semble impossible.
Et pourtant, au milieu du cynisme, il y a de l’espoir. Le changement arrive par cycles. L’histoire montre des balancements vers le meilleur et vers le pire. Je crois que le monde basculera de nouveau vers le bien, et que nous retrouverons notre humanité.