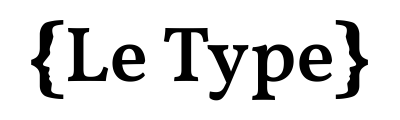Retour sur une expérience d’ateliers radiophoniques pensée pour que des jeunes en situation de fragilité ou de handicap puissent s’exprimer, par la parole ou l’écriture. Portées par des structures bordelaises, ces temps de médiation sont autant des espaces d’expression que de partage pour ses participant·es. À l’initiative de la démarche, la co-fondatrice et présidente de l’association à bien des égArts revient sur les étapes de la réalisation de cette fiction radiophonique.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.
Crédit photo : Morgane Foitih
Un souvenir, « c’est quelque chose de précieux », raconte Victoria dans le podcast Souvenirs d’enfance, rêves de demain. Cette fiction radiophonique est l’aboutissement du projet d’éducation artistique et culturelle (EAC) porté par l’association à bien des égArts, en collaboration avec quatre structures bordelaises – l’ULIS collège de Sainte-Marie Grand Lebrun, le DITEP Stéhélin, la Bibliothèque Pierre Veillet et et le Centre d’animation Monséjour – et mené par l’autrice Lucie Braud (membre du collectif d’artiste-auteurs Un Autre Monde situé au Bouscat) ainsi que la journaliste radiophonique Emmanuelle Lagadec, créatrice de La Barque à sons.
Cette aventure collective et passionnante, qui s’est déroulée pendant deux semaines au cours du premier semestre 2025, est désormais un souvenir précieux commun à tous les jeunes adolescent·es qui y ont participé. Retour sur cette odyssée radiophonique hors normes.


Des projets culturels participatifs
Mars 2025. Dix jeunes de l’ULIS collège de Grand Lebrun, accompagné·es de leurs éducateurs et éducatrices, et deux élèves de troisième du même établissement rencontrent pour la première fois au Centre d’animation Monséjour, à Bordeaux, six jeunes du DITEP Stéhélin, encadrés par trois éducatrices spécialisées. Toutes et tous ont quitté leur établissement quotidien pour venir participer à la première semaine d’ateliers artistiques menés par Lucie Braud et Emmanuelle Lagadec. La présidente de l’association à bien des égArts est présente à ce premier rendez-vous qui marque le début d’un projet préparé depuis de longs mois, le quatrième depuis la création de cette association en 2021.
Cette structure bordelaise a pour mission de monter des projets culturels participatifs mettant en pratique la parole, l’écriture ou l’image auprès de jeunes (11-18 ans) en situation de fragilité ou de handicap. Elle sollicite en premier lieu les établissements d’accueil et d’enseignement spécialisés (ULIS, ITEP, IME…) et des auteurs ou autrices dont elle apprécie l’univers artistique et qui ont une appétence particulière pour des actions de médiation auprès de publics spécifiques. Son rôle est de mettre en relation toutes les parties prenantes afin de construire en collaboration des projets inclusifs dans un souci d’engagement de chaque participant·e et de respect réciproque.

Aller vers les autres
Tout est affaire de rencontre, de volontés et de sensibilités qui s’accordent. Une synergie qui a opéré à tous les niveaux dans cette aventure pensée à l’échelle d’un quartier (les quatre structures concernées se situent dans un même périmètre géographique) : les éducateurs et les éducatrices, dont certain·es se connaissaient déjà, ont enrichi leur savoir-faire au contact de leurs homologues. Les deux autrices, qui travaillaient ensemble pour la première fois, ont su accorder avec brio leur approche respective. Les jeunes, enfin, aux profils si divers, ont appris à se connaître et ont lié pour certains de nouvelles amitiés.
Une ouverture à l’autre que souligne Stéphanie Gimenez, éducatrice au SESSAD, à propos des adolescent·es dont elle s’occupe : « Ce sont des jeunes avec des besoins spécifiques mais qui sont empêchés, à un moment donné, dans leur parcours de vie. L’idée de l’ITEP, et de notre travail, grâce à ces projets-là, c’est de les aider à pouvoir trouver une ouverture, de titiller leur curiosité, pour qu’ils puissent ensuite aller vers les autres. Je trouve que ce projet était en lien avec le travail que l’on fait au quotidien. »
C’est encore l’importance de la relation humaine, dans ce genre d’aventure, qu’évoque Liam, élève de l’ULIS : « Ce que j’ai adoré dans le projet, c’est d’être entouré de bonnes personnes. Même si l’ensemble du projet était bien, c’est grâce à vous tous que ces moments resteront gravés dans ma mémoire. Donc un grand merci à vous, je ne vous oublierai pas. »

Écrire et dire ses souvenirs. Et ses rêves…
Ainsi s’est construit un beau souvenir commun, thème qui était justement l’un des fils rouges de ce travail, avec celui des rêves. Ce sujet, proposé par Lucie et Emmanuelle, est universel : nous avons toutes et tous des souvenirs et des rêves. Il permettait aussi à chacun·e d’être dans sa singularité et d’ouvrir les possibles de l’écriture, en mêlant réel et fiction, floutant parfois la frontière entre les deux afin que les auditeur·ices ne puissent pas toujours démêler le vrai du faux. Mais peu importe, car au final, ce qui est dit dans cette fiction radiophonique, est le reflet d’une intimité partagée : « Du souvenir au rêve, nous, adolescents, en les racontant, nous vous parlons de qui nous sommes, de nos désirs, de nos joies et de notre imaginaire. »
Pour amener les jeunes à s’exprimer, Lucie Braud commence par leur lire des albums jeunesse, une méthode qu’elle utilise souvent dans le cadre de ses ateliers de médiation, quels que soient les publics, y compris les adultes : « Je travaille à partir d’albums jeunesse car ce sont des œuvres très riches qui font appel à une double narration, l’image et le texte. Cela permet d’ouvrir le champ de la lecture, les interprétations, d’enrichir l’imaginaire. »
Les adolescent·es ont écouté avec une attention aiguë – et vraiment inhabituel chez certains d’entre eux ! – ces séances de lecture qui ont ponctué les ateliers. Ainsi, les jeunes se sont inspiré·es de l’album Ce qui sera, de Johanna Schaible, pour écrire leurs souvenirs dans une anaphore de « Il y a » aux accents poétiques : « Il y a dix ans, j’ai rencontré le plus vieux monsieur du monde. Il y a un an, on m’a trahi. Il y a quinze ans, je poussais mon premier cri. Il y a un an, c’était génial, car l’époque était joyeuse… »
Quand tu laisses un espace d’expression sans pression, sans attente particulière et que tu encourages cette prise de parole avec bienveillance, cela fonctionne presque toujours
Emmanuelle Lagadec (journaliste)
Passée l’étape de l’écriture, il a fallu lire, dire et parler au micro… Un autre défi, relevé cette fois-ci par Emmanuelle Lagadec, qui, par petit groupe et aidée par les éducateurs (qui ont participé, au même titre que les jeunes, à toutes les phases du projet), a réussi à faire parler chacun et chacune, y compris celles ou ceux qui avaient des troubles sévères du langage. « Quand tu laisses un espace d’expression sans pression, sans attente particulière et que tu encourages cette prise de parole avec bienveillance, cela fonctionne presque toujours », explique la journaliste. La qualité de la fiction produite ne doit pas faire oublier à quel point ces jeunes ont su dépasser leurs appréhensions, leurs peurs, même, pour aller au-delà de leurs limites et se prouver à eux-mêmes qu’ils en étaient capables.

… les partager
C’est une forme de fierté, et de plaisir aussi, qui brillait ainsi dans leurs regards et dans ceux de leur famille et amis lors de la restitution qui s’est déroulée à la Bibliothèque Pierre Veilletet. Sous la forme d’une écoute collective de la fiction radiophonique créée, ce moment de partage, suivi d’un échange avec la salle, a permis aux jeunes, aux éducateurs et aux autrices d’exprimer en public ce que ce projet leur avait apporté.
Laissons ainsi le mot de la fin à Bertille, élève de troisième générale, qui a choisi de participer à cette aventure : « Sincèrement, je n’aurai jamais imaginé l’impact qu’aurait ce projet sur moi. Alors je n’ai qu’une chose à vous dire : merci. Merci aux deux intervenantes, Lucie et Emmanuelle, qui nous ont accompagnés tout au long du parcours et ont réussi à nous faire poser des mots sur des thèmes durs à aborder. Merci aux éducateurs pour leur engagement, leur bonne humeur et leur dévouement. Et enfin, merci à chacun d’entre vous, élèves d’ULIS, de l’ITEP et du SESSAD. Merci pour les rires, les découvertes et les foots. Merci pour tous ces moments partagés ensemble et ces beaux souvenirs. Une chose est sûre, je ne vous oublierai pas. »
- Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.