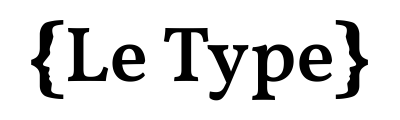Depuis le 3 juillet et jusqu’au 4 janvier 2026, le Frac MÉCA ouvre ses portes à une nouvelle exposition consacrée à l’aïta. Ce genre musical, né au Maroc, puise ses dires dans les louanges à Dieu, à l’amour, et surtout à la lutte. Il devient la trame d’un voyage sensible intitulé Aïta, fragments poétiques d’une scène marocaine. À partir de cet art oratoire, la commissaire Sonia Recasens a déroulé plusieurs fils narratifs, afin de synthétiser et de rendre hommage à la richesse de l’art marocain.
Explorer son intimité
À peine les portes du FRAC franchies, une clameur nous saisit. Elle provient de l’une des premières œuvres exposées : une vidéo de performance intitulée Corbeaux de Bouchra Ouizguen dans laquelle des danseuses s’engagent dans une quête d’un cri singulier. Ce hurlement instinctif, devient comme le point de départ de l’aïta (littéralement, la « voix puissante »). En cherchant ce cri, elles révèlent une sensibilité profonde, une ode aux mères qui traversent diverses expériences de vie, de la naissance au deuil.
Durant ce voyage identitaire, les artistes marocain·es se racontent et l’emplacement des œuvres choisies permet de créer des ponts. On y retrouve des artistes de la même famille (Amina Agueznay faisant face à sa mère, Malika Agueznay), venant de périodes différentes, ce qui déclenchent des dialogues inattendus mais harmonieux.
Dans ces œuvres présentées, un lien fort unit toujours l’oral et l’écrit. Un grand nombre d’artistes ont appris leur langue à l’oral et ne savent pas l’écrire, ce qui donne lieu à un travail de recherche calligraphique, voire d’invention de leur propre langage manuscrit. Divisée selon différentes thématiques, l’exposition mêle supports, formes et matériaux.

Briser les chaînes coloniales
La présence de la langue coloniale se fait sentir dans cette exposition. Comment s’en émanciper ? L’une des œuvres exposées, Terre Mère de Malika Agueznay, illustre les nouveaux codes adoptés par les élèves des Beaux-Arts de Casablanca lorsque Farid Belkahia en a repris la direction. L’objectif était de se libérer du poids de l’académisme occidental, où l’on y enseignait entre autres le français et un art européen, pour embrasser pleinement leurs propres richesses culturelles.
Des exemplaires de la revue Souffles y sont également présentés. Publié à partir de 1966 et interdit en 1972, cet ouvrage faisait dialoguer artistes et poètes, en portant un regard avant-gardiste sur la société marocaine. À travers des numéros parfois bilingues, elle diffusait des articles politiquement engagés.
Genres, luttes et identités invisibles
La série photographique La Chasse aux papillons de Yasmine Hatimi interroge l’influence du patriarcat sur les constructions masculinistes et constitue une réponse frontale au racisme décomplexé dont les hommes racisés sont la cible dans les médias. Elle donne à voir une autre facette de la masculinité marocaine, empreinte de douceur et de sensibilité. La question de l’identité queer est également abordée à travers le travail de l’artiste Sido Lansari, qui présente une tenture brodée de six mètres de long. Il y exprime en lettres dorées la double invisibilisation dont il fait l’objet, à la fois au sein du « mouvement gay homo » et de la part de ses propres « compatriotes » (cf. This Dream Is Restless).

La dernière œuvre présentée, installée dans l’espace « Tradition futuriste », est un documentaire de Meriem Bennani. Elle y détourne les codes de la téléréalité et des réseaux sociaux pour dresser le portrait de deux cheikhates (pluriel de cheikha, chanteuse de l’aïta) issues de générations différentes. La réalisatrice y raconte la transmission de l’aïta et interroge son avenir. L’exposition fonctionne alors comme une boucle entre mémoire et luttes avant de revenir au cri de l’âme.