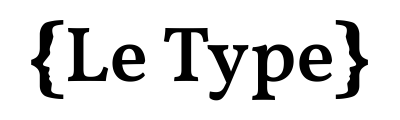État des lieux du traitement et des représentations liées au handicap mental sur les scènes de théâtre de Gironde. Du tnba à La Manufacture CDCN en passant par le Glob Théâtre, cette question semble de plus en plus considérée par les institutions culturelles du territoire, même si le chemin est encore long.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.
Crédit photo : Philippe Savoir (De Françoise à Alice)
À deux pas des quais de la Garonne, le Théâtre National Bordeaux Aquitaine (tnba) trône en majesté. Avec sa riche programmation, ce Centre dramatique national, aux côtés d’autres pôles artistiques girondins, a mis, depuis plusieurs années, l’accent sur le handicap mental au plateau et dans les salles. De la pièce chorégraphique De Françoise à Alice proposé à La Manufacture CDCN au spectacle Les frères Sagot organisé en partenariat avec le Glob Théâtre, état des lieux d’un sujet encore peu abordé sur les scènes de théâtre françaises.
L’accessibilité, à tous les niveaux
En septembre 2025, le ministère de la Culture a publié ses chiffres liés au taux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les principales institutions culturelles : « 95% pour les établissements publics, 66% pour les scènes nationales (SCN), 80% pour les sites gérés par les Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC) et 90% concernant les structures labellisées ».
Qu’en est-il pour le handicap mental ? Au tnba, Véronique Aubert, responsable du service des relations avec les publics, apporte une première réponse : « J’ai pris le champ du tout public, y compris avec les personnes qui ont des problèmes d’adaptabilité. Je travaille avec des instituts médico-éducatifs (IME), des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)… » Elle indique par ailleurs être particulièrement « attentive à la question de quels spectacles peuvent convenir à un public porteur d’un handicap mental, comme des représentations destinées à une jeune audience. L’objectif est de ne pas les enfermer dans des cases et qu’ils aient accès à des choses variées ».
En parallèle, Véronique Aubert confie proposer des parcours avec une visite des lieux et l’organisation d’ateliers d’initiation à la pratique théâtrale. Elle précise néanmoins que le tnba « fait de l’art mais pas de l’art thérapie ». Le terme de médiation culturelle semble plus approprié : ces initiatives permettent d’amener des femmes et des hommes, de tous âges, en un endroit parfois considéré comme étant inaccessible. « Ma force est tournée vers eux », poursuit-elle.

Parler du handicap, sans tabou
En 2024, le tnba a accueilli la pièce de Luis et Jules Sagot, Les Frères Sagot. Le premier parle de son handicap mental, sans tabou. « Il aime beaucoup interagir avec les autres », explique Véronique Aubert. « La pièce est construite de manière à ce que cette thématique soit toujours abordée, en décalage, entre récit de vie et bonheur ».
Jules Sagot, ancien élève de l’école du théâtre, connaissait déjà bien l’endroit. « Il avait très envie de vivre la vie de comédien de Luis. » Afin de respecter les besoins de chacun·e, les horaires ont été aménagés avec une séance à 14h30, notamment pour celles et ceux qui sont dans l’impossibilité de sortir le soir ou qui ont besoin d’être accompagné·es. La durée de la pièce, soit une heure, convient bien à un public qui peut avoir des problèmes d’attention. « Ensuite, des bords de scène ont eu lieu après chaque représentation » se souvient Véronique Aubert. Les retours, nombreux et touchants, apportent un réconfort aux comédiens comme aux spectateurs. L’un deux a témoigné avec ces mots : « cela me fait du bien de voir des gens comme moi. »
De nos jours, le handicap mental est moins rédhibitoire pour faire carrière
Marie Astier (chercheuse et metteuse en scène)

« Qui voit-on sur scène ? »
En mars 2024, la chercheuse, metteuse en scène, et comédienne Marie Astier a tenu une conférence au tnba sur la représentation du handicap mental au théâtre. Cette ancienne Normalienne y a d’ailleurs consacré sa thèse.
« À ce moment-là, plusieurs questions ont émergé », se rappelle-t-elle. « Qui voit-on sur scène ? Comment écrit-on du point de vue d’un personnage se trouvant dans cette situation ? » Autant d’interrogations qui ont poussé Marie Astier à s’employer à l’étude des compagnies théâtrales, telles que Catalyse ou L’Oiseau Mouche, respectivement situées à Morlaix et à Roubaix, et dont les comédien·nes sont toutes et tous porteurs d’un handicap mental.
Si l’Oiseau Mouche ne le met pas en avant, Catalyse, qui comprend sept artistes, a été créé par Madeleine Louarn, leur ancienne éducatrice spécialisée. « Tout le monde est distribué sur les productions », affirme Marie Astier. « De nos jours, le handicap mental est moins rédhibitoire pour faire carrière. »
En 2012, la comédienne a assisté à la pièce Les Oiseaux, d’après Aristophane et mis en scène par Madeleine Louarn. « À l’époque, j’avais été mal à l’aise. Il y avait un dispositif avec des sur-titrages et je me suis demandé pourquoi ? Ils parlent pourtant la même langue que moi. À travers mon travail, j’ai aussi voulu résoudre cette équation : je n’avais alors pas les bons critères de jugement esthétique. »

Voir les choses de l’intérieur
Du côté du public, Marie Astier souligne la nécessité des représentations Relax, qui consiste à « laisser la salle un peu allumée et de se présenter à chacun·e, pour que tout le monde se sente bien ». Lors de sa conférence, elle a essayé « de vulgariser le plus possible ». Dans la salle étaient présents des gens du monde du spectacle, du médico-social et des personnes en situation de handicap : « J’ai voulu rendre le tout interactif ».
Très impliquée sur le sujet, elle co-anime par ailleurs tous les étés un stage intitulé « Jouer, chercher, inclure ». Avec son ami Clément Papachristou, artiste associé au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, elle organise également des workshops avec des comédien·nes professionnel·les, valides ou non : « Je suis dans une posture de formatrice, je ne joue pas avec eux mais j’aime bien voir les choses de l’intérieur ».
Une rencontre inattendue
Lorsque le chorégraphe Mickaël Phelippeau parle de sa rencontre inattendue avec Françoise et Alice Davazoglou, en 2015, il est ému. Cette dernière est fondatrice de l’association Art 21 et forme des danseuses et des danseurs, handicapé·es ou non. Cette année-là, elle l’invite et ensemble vont créer un atelier mixte. En 2016, l’échange se poursuit avec un format plus long, mêlant danse et photographie.
« Cela avait lieu à 10 heures le samedi à Lens et je ne pouvais pas arriver en train dans la journée. Je dormais chez Françoise. Nous avons beaucoup parlé, jusque tard dans la nuit, sur le bouleversement qu’a eu la naissance de sa fille Alice dans son existence », se remémore Mickaël Phelippeau. Ainsi est née l’idée du spectacle De Françoise à Alice, un an plus tard, après « avoir passé une semaine en studio tous les trois, puis à L’Échangeur-CDCN à Château-Thierry ».
Trisomie 21 et intermittence du spectacle : une ouverture des possibles
Alice interrogea sa mère en lui demandant un jour comment elle est née. Ce à quoi celle-ci répondra : « Tu as décidé de me faire pleurer dès le premier jour ». Aujourd’hui, Alice Davazoglou est l’une des seules artistes avec une trisomie 21 à être intermittente du spectacle. Une singularité pour celle qui est aussi écrivaine et dessinatrice.
En 2022, en amont de la représentation à la Maison des Arts de Pessac, Mickaël Phelippeau a donné un workshop à la Manufacture CDCN. Quant à Alice et Françoise, elles ont participé à un atelier au tnba, toujours en rapport avec le handicap. Elles se souviennent d’un moment particulièrement encourageant : « La mère d’un petit garçon trisomique est venue me dire que ces interventions lui donnaient de l’espoir et du soulagement de savoir que l’on peut avoir un vrai parcours professionnel, malgré notre différence. » L’ouverture des possibles est en marche.
- Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.