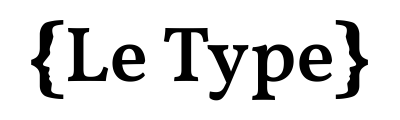Du 27 novembre au 1er décembre, le festival Afrique en vision revient à Bordeaux pour sa cinquième édition. Cinq jours pour changer de regard sur le cinéma africain, aux côtés des nouvelles générations de réalisateurs et réalisatrices ainsi que des pionniers du septième art du continent. Pour l’occasion, on a posé quelques questions à Dana Khouri, coordinatrice de l’Institut des Afriques, association organisatrice de l’événement.
Crédit photo : Flore Poudroux
Le Type : En quoi Afrique en vision est-il un espace de déconstruction des imaginaires français vis-à-vis des cinéastes africains et africaines ?
Dana Khouri : La programmation d’Afrique en vision s’inscrit dans une ligne historique portée par l’Institut des Afriques. L’objectif est de faire de ce festival un relais des voix et des visions des cinéastes africain·es, en mettant en avant ce qu’ils et elles veulent montrer de l’industrie cinématographique contemporaine.
Cette programmation est construite en collaboration avec Documentary Africa (Kenya), le Festival international du documentaire d’Agadir, AfriCiné Magazine, la chaire Diaspora africaine et transculturalité de l’Université de Bordeaux, et le cinéma Utopia.
L’idée est de créer un dialogue entre ces partenaires pour refléter les narratifs qui émergent aujourd’hui sur le continent africain. Nous accordons une attention particulière au patrimoine et au matrimoine cinématographique africain, notamment à travers les films d’archives et les œuvres restaurées. On constate qu’il y a eu une production foisonnante dès les années 1950, mais beaucoup de ces films restent à restaurer. Des initiatives, comme celles de la Cinémathèque Afrique, s’engagent activement dans cette restauration.
Une nouvelle génération de cinéastes se réapproprie cet héritage et le réinterprète. Par exemple, La vie après Siham, présenté cette année, explore la perte de la mère du réalisateur tout en convoquant l’héritage de Youssef Chahine. Namir Abdel Messeeh, le réalisateur, sera présent pour discuter de cette mémoire réinvestie par les cinéastes actuels. Nous organisons également un focus le 29 novembre avec la projection de Reou-Takh de Mahama Johnson Traoré, un film avant-gardiste qui posait déjà, dans les années 1970, des questions sur la décolonisation.
Le titre de notre focus, « Réinvestir la mémoire des cinéastes africains », illustre cette volonté : montrer comment ces films, à leur époque, étaient déjà à l’avant-garde des revendications actuelles.
Dana Khouri (Institut des Afriques)


Vous avez cette année choisi le thème « l’Afrique comme métaphore ». Est-ce que cela s’inscrit dans cette portée symbolique et politique de restauration de l’héritage culturel du continent africain ?
La restauration de l’héritage fait partie intégrante de cette métaphore, mais il ne s’agit pas d’un héritage figé. La métaphore est en constante actualisation, en constant renouvellement. Le titre de notre focus, « Réinvestir la mémoire des cinéastes africains », illustre cette volonté : montrer comment ces films, à leur époque, étaient déjà à l’avant-garde des revendications actuelles.
Autour de Reou-Takh, une table-ronde réunira Cassiopée N’Sondé, responsable de la Cinémathèque Afrique, et Dhia Jerbi, réalisateur tunisien engagé dans l’Archive Circulation Initiative. L’enjeu est aussi de questionner : où ces films sont-ils restaurés ? Est-ce qu’ils le sont uniquement à Paris, ou existe-t-il des initiatives panafricaines ? Ces initiatives existent et s’engagent, comme le collectif de cinéastes panafricains qui a restauré Le Massacre de Thiaroye l’année dernière. Touda Bouanani, figure bordelaise et marocaine, travaille également sur les archives de son père, Ahmed Bouanani, à travers les arts visuels, le cinéma et l’édition.
L’idée est de créer un dialogue entre les générations et de réinvestir cette mémoire de manière innovante. On aura aussi le témoignage de Catherine Ruelle, ancienne journaliste à RFI et critique de cinéma. Elle a accompagné des cinéastes comme Ousmane Sembène ou Youssef Chahine.
La sélection des films programmés pendant Afrique en vision est entièrement collective (…). C’est un processus de dialogue et de consultation permanente.
Dana Khouri (Institut des Afriques)

Tu as évoqué plusieurs structures partenaires. Comment s’effectue la sélection des films programmés lors d’Afrique en vision ?
La sélection est entièrement collective. Nous ne posons aucun critère de notre côté. Même la présélection des films est faite en collaboration avec nos partenaires. Chaque partenaire propose les titres qu’il souhaite voir dans la programmation finale. Nous les visionnons tous, puis nous nous réunissons pour faire la sélection ensemble. C’est un processus de dialogue et de consultation permanente. Parfois, des contraintes financières nous obligent à ajuster, mais nous revenons toujours vers les partenaires pour trouver des solutions.
L’une des lignes directrices d’Afrique en vision est de montrer des films qui ont peu de chances de sortir dans les salles françaises, bien qu’ils soient primés dans les festivals internationaux. L’idée est de proposer une alternative aux films africains qui arrivent à Cannes. C’est un engagement politique : révéler des récits qui ne sont pas encore connus du public français, et offrir une pluralité de regards.
Afrique en vision devient ainsi un acte politique : rendre audibles ces histoires, les positionner sur la scène bordelaise.
Dana Khouri (Institut des Afriques)
Comment le public bordelais réceptionne-t-il le festival ?
Une étude réalisée l’année dernière par une anthropologue présente tout au long du festival a révélé que le public vient à Afrique en vision pour sa dimension informative et pour découvrir des récits alternatifs. Il cherche aussi à redécouvrir cette mémoire du cinéma africain, ces images perdues. Beaucoup ont entendu parler d’Ousmane Sembène ou de Djibril Diop Mambéty, mais n’ont jamais eu l’occasion de voir leurs films. Les salles sont souvent pleines, avec un engouement du public, qu’il soit issu des diasporas africaines ou non.
Cette année, pour toucher de nouveaux publics, nous proposons une séance dédiée aux tout-petits. C’est une première. L’idée est de montrer que découvrir ces films est un privilège, même pour les enfants de 4 ans.

En quoi la programmation d’Afrique en vision reflète une volonté de réappropriation de certaines œuvres culturelles par les communautés afro-diasporiques en Nouvelle-Aquitaine ? Notamment dans un contexte géopolitique pour le moins tendu…
C’est un enjeu essentiel. Depuis cinq ans, nous montrons des récits inédits et alternatifs, porteurs d’une forte dimension politique. Chaque film a une portée politique, qu’il aborde des questions sociétales, des relations maternelles, des révoltes ou des questions de genre.
Ces luttes ne sont pas détachées de la nécessité de corriger le point de vue colonial. Il est temps de laisser les personnes concernées par cette histoire exprimer leurs problèmes et leurs aspirations. Afrique en vision devient ainsi un acte politique : rendre audibles ces histoires, les positionner sur la scène bordelaise. C’est déjà énorme, car c’est un festival inédit dans la région.
Pourquoi avoir fait le choix de multiplié les lieux de projection cette année ?
L’enjeu est de rendre ces récits accessibles au plus grand nombre. Une fois la programmation finalisée avec nos partenaires africains, nous l’envoyons à des partenaires locaux, comme le Rocher de Palmer, le Dietrich à Poitier, ou la Maison des Mondes Africains MansA à Paris. Ils connaissent mieux leur public et leur territoire, et proposent des films adaptés. Nous voulons aussi dialoguer avec les dynamiques existantes, comme l’exposition Aïta au FRAC Nouvelle-Aquitaine.
Quel regard portes-tu sur l’évolution du festival depuis sa création ?
Je ne vois pas vraiment de défauts à Afrique en vision. C’est un festival qui permet de refléter les voix du continent africain, de fédérer un collectif d’acteurs locaux et régionaux, et de rassembler des publics variés autour de débats qui les touchent.
À long terme, il faudrait plus de moyens pour durer et intégrer d’autres genres, comme la réalité virtuelle, qui peut être un outil puissant pour déconstruire les préjugés.
Quels sont les 5 films immanquables de cette édition ?
Je dirais pour commencer Bal poussière que nous proposons en film d’ouverture cette année. Ce film des années 1980 d’Henri Duparc déconstruit les clichés sur la polygamie en Afrique, avec humour et sans caricature. On le programme avec Mi Okkitiri Adama, un court-métrage récent d’un étudiant bordelais sur un mariage au Sénégal, créant un dialogue entre les générations.
Il y a aussi La vie après Siham, un film intime où le réalisateur aborde la perte de sa mère, tout en rendant hommage à Youssef Chahine. C’est une œuvre qui mêle histoire personnelle et mémoire cinématographique. Citons aussi How to Build a Library, un documentaire kenyan explorant la décolonisation des bibliothèques. Il offre des pistes concrètes pour repenser l’accès aux littératures africaines et afro-diasporiques, même en France.
Je pense aussi à Yelen de Souleymane Cissé. Il s’agit d’un film avant-gardiste où les objets d’art africains ne sont pas de simples décors, mais des éléments centraux du récit. Il propose une approche inédite qui donne toute sa profondeur à l’histoire. Encore un autre : Nationalité : immigré de Sidney Sokhona, sorti en 1975. Ce film historique sur le racisme systémique est précédé de la performance Ils sont nombreux à marcher dans les yeux de Wong-Youk-Hong, une création de la Compagnie du Risque mise en scène par Laetitia Ajanohun. Cette performance relate, à partir des photos de Wong-Youk-Hong les marches de Selma et Marseille en 1983. Un rappel puissant que ces luttes restent d’actualité en 2025.
Un mot enfin sur The Night Still Smells of Gunpowder : un film mozambicain poignant qui aborde la mémoire taboue de la guerre civile à travers le regard d’une grand-mère atteinte d’Alzheimer. Une œuvre qui déconstruit le silence autour de cette histoire.
Afrique en vision est un festival qui concrétise tout ce pour quoi l’Institut des Afriques existe : révéler des récits inédits, engager des débats, et ouvrir la voie aux créations panafricaines et afro-diasporiques d’aujourd’hui.
Dana Khouri (Institut des Afriques)
Pourquoi ces films ?
Ces films résument l’esprit du festival : des récits qui dérangent, questionnent et créent des ponts entre le passé et le présent. Chaque année, ils nous laissent avec des questions et une envie d’en savoir plus.
Comment résumer le mantra de l’Institut des Afriques pour cette édition ?
« Être ensemble. » Pendant cinq jours, on a l’impression d’être en famille, avec le public, les réalisateur·ices, les partenaires. La soirée de clôture sera placée sous le signe des 10 ans de l’Institut des Afriques. C’est un festival qui concrétise tout ce pour quoi nous existons : révéler des récits inédits, engager des débats, et ouvrir la voie aux créations panafricaines et afro-diasporiques d’aujourd’hui.